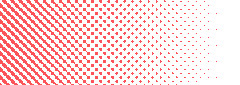Sons et voix dans l’écriture de Maylis de Kerangal
Introduction
1Cris de mouettes et de garçons, rires, voix, grondements de ressac, hurlements de motos et de voitures, tels sont les sons, autant de perceptions et de sensations qui amplifient la prose de Maylis de Kerangal. L’écrivaine faisait déjà écouter sa musique impétueuse dans Dans les rapides1 et dans Corniche Kennedy2, où elle mettait en scène les plongées dangereuses d’adolescents déterminés à « coïncider avec tout ce qui respire » (CK : 60). Tous ces différents matériaux narratifs étaient tenus ensemble par les sensations liées aux paysages et à la lumière, mais aussi aux sons, confiés à l’alternance des répétitions ainsi qu’à un choix lexical ciblé, toute une matière qui a façonné ses personnages. Depuis Corniche Kennedy, l’horizon littéraire de Maylis de Kerangal s’est s’élargi en nous donnant à lire l’aventure à la fois intime et collective d’une véritable épopée humaine avec une écriture en prise directe avec le réel, mais surtout avec ses sonorités. Croisée par de multiples réflexions historiques, politiques, économiques, sociales, techniques et surtout humaines, l’œuvre de M.d.K. conjugue l’utopie du travail en commun ou, dans tous les cas, de l’“être ensemble”, et les espaces gris de l’intime. Le son et la voix peuvent se faire moteur de la narration dans son œuvre ? Et, pour dire quoi ? C’est la question qui a déclenché cette étude autour de ses ouvrages et notamment à l’occasion de la parution de Canoës3.
2Si, comme le souligne Dominique Viart, M.d.K. fait partie d’une génération d’écrivains qui cherche « à faire du romanesque avec presque rien4 », en essayant de saisir les soucis de la société actuelle, tout en sortant de nouvelles formes de construction de soi et de l’autre, son écriture semble réunir en un seul mouvement réalité et fiction pour traverser le présent avec un regard lucide sur la complexité des rapports humains. Prises dans l’énergie du mouvement, les voix des personnages s’avèrent des tensions qui, du plaisir à la souffrance, s’expérimentent souvent dans la chair, et finissent par la dépasser, se confrontant à la matière et tâchant à la transformer ou à capter la vitalité qu’elle dégage tel qu’il se passe dans Réparer les vivants5. Nourries par une information minutieuse du réel, ses phrases décrivent une coulée, à la fois corporelle et mentale, au moyen d’une écriture qui multiplie les points de vue — pensons également à Naissance d’un pont6 ou à À ce stade de la nuit7 —, en passant sans cesse du collectif à l’individuel, du « grand » des aventures communes au « petit » des destins personnels. C’est toute une humanité qui affleure dans son écriture ainsi qu’une pluralité de voix auxquelles nous souhaitons accorder notre attention dans cette étude, articulée en deux parties focalisées autour du passage d’une écriture sonore à une écriture vocale.
De l’écriture sonore…
3Au‑delà du regard sur l’adolescence désabusée et la société dont Marseille constitue le microcosme, dans Corniche Kennedy, c’est l’écriture qui l’emporte, une écriture qui passe au crible les corps, les espaces — « la plate‑forme — ils disent la Plate — est une portion de territoire longue de trente mètres environ, large de huit » (CK : 15) —, les temps — « ils vont venir quand le printemps est mûr, tendu, juin donc, juin cru et aérien » (CK : 11) — aussi bien que les sons :
Ils s’agglutinent les uns aux autres, se touchent, se frottent, se bousculent, se font la bise — si fille‑fille ou fille‑garçon —, se tapent dans la main, paume sur paume, poing sur poing, phalange contre phalange — si garçon‑garçon —, s’invectivent, exclamatifs, crus, juvéniles […] clameur splendide, brouhaha qui les fusionne autant qu’il les fissure, éclate, mat et sec. (CK : 13).
4Comme les plongées sur la Corniche, les phrases se succèdent à un rythme soutenu, les mots évoquent des sensations fortes, externes — les plongées —, et internes — les sensations —, dans le cadre d’une opération agile et énergique de ciselage et détourage pour enfin capter les bruits du monde.
5La géométrie complexe du groupe évolue en un ballet continu, à travers une pulsation de la parole qui envahit les relations entre les individus, dans le cadre d’un texte dense qui balaie les temps morts et offre au récit une énergie contagieuse. Le son passe par la combinaison des bruits de la quotidienneté familiale et urbaine — « Les planches […] distillent les musiques et les bruits : chocs d’assiettes, raclements de chaises, éclats de voix, rires, tubes de l’été et sirènes de police ululant dans la nuit » (CK : 149), mais aussi des expressions différentes de la voix humaine — « Course d’élan, bondissement dans les airs, hurlements sauvages, éclaboussures comme des détonations, appels et cris, les voix sont soulevées par l’écho de la mer » (CK : 41). Ainsi qu’à travers l’élément sonore passe l’union entre les individus, en particulier, de ces gars qui, unis par un même cri, sautent avec le sentiment d’être une seule entité, un corps collectif, une seule bande son d’un univers partagé — « Se précipitent alors dans le ciel, dans la mer, dans toutes les profondeurs possibles, et quand ils sont dans l’air, hurlent ensemble, un même cri, accueillis soudain plus vivants et plus vastes dans un plus vaste monde » (CK : 48).
6La bande d’adolescents protagoniste du roman, « les petits cons de la Corniche. La bande », partage la même joie jusqu’à l’exaltation lorsqu’ils se lancent, fiers de défier l’interdit et d’échapper un instant à la réalité — « Et quand ils précipitent de là-haut, c’est la même crue qui les traverse, une crue de l’espace et du temps, une amplification de la lumière, une saisie de la joie » (CK : 31). Ensuite, l’écriture pointe l’aventure collective — comme cela arrive aussi dans Naissance d’un pont —, qui passe par une accélération mettant en scène une sorte de guérilla urbaine entre la bande de la Plate et la police. La Corniche, comme le pont donc, qui réunit une foule de personnages dont le profil se découpe dans le texte, à la fois net et nuancé. Ils ne se connaissent pas, ils se touchent avec des intentions différentes — certains viennent pour l’argent, d’autres pour le défi technique, d’autres encore pour échapper à une existence dont ils ont voulu changer le cours8. Mais tous sont animés dans un effort collectif vers le même but, avec la même conscience — « la certitude d’une force, ouais, on reste, le pont c’est nous » (NP : 221).
7Hymne à la vie, au‑delà de la mort, Réparer les vivants est un roman à la forte connotation chorale et auditive, qui mélange différents sons et les renvoie à travers une structure singulière dans laquelle la fiction narrative est véhiculée par la dimension sonore — « L’idée du chant a présidé au livre. Le chant est le paysage du livre, le paysage, c’était le corps de Simon9 », remarquait M.d.K. à l’occasion de la présentation de Réparer les vivants, un roman dont le personnage principal est un organe, un cœur, sur la scène d’une narration qui se déroule sur une journée. L’écriture de Réparer les vivants pointe l’idée de limite et de passage, c’est une sorte de voyage dans une zone à la lisière, comme si la séparation entre vie et mort était annulée.
8Dans ce cadre, seule l’intensité du chant, cette force qui se dissocie du langage pour s’affermir, peut attribuer à la mort un caractère de sacralité. En rassemblant les restes de Simon pour les livrer à sa famille, Thomas Rémige chante une dernière mélodie pour accompagner le défunt. Face à une fin inattendue, une mort accidentelle, la langue se retrouve soudain inhibée. Si dans Naissance d’un pont la construction d’un énorme pont coagule une masse de gens sous l’égide de la création, dans Réparer les vivants l’on reconstruit à partir de la mort. La greffe constitue une sorte de transfert entre l’individu et la communauté, qui se jette dans un corps collectif ; un geste qui vise à reconstruire un lien social. Réparer les vivants c’est un « Chant de la réparation » dans la mesure où tous ceux qui interviennent dans cette « chaîne humaine héroïque » (RLV : 272) de la greffe reçoivent en retour quelque chose du résultat positif de l’opération. Simon lui‑même se retrouve paradoxalement réparé après la reconstitution de son corps suite au prélèvement des organes — « La restauration du corps du donneur […] c’est une réparation » (RLV : 265). Au final, il n’y a pas que Claire qui se fait réparer. Dans son essai Réparer les vivants, Alexandre Gefen souligne : « Le récit de Maylis de Kerangal répare de multiples injustices propres aux discours communs10 ».
9Tout comme Corniche Kennedy et Naissance d’un pont, Réparer les vivants se révèle une aventure collective autant que technique avec un même but, tout en s’avérant plus intime et charnelle. La trajectoire de la greffe acquiert les semblances d’un chant, une reprise de voix en voix de par chacun des personnages, le médecin, l’infirmier qui coordonne les opérations, le chirurgien. Chacun avec la densité de sa propre histoire. Au milieu, le protagoniste, Simon, ou bien, son cœur.
10Construit par des fragments plus ou moins amples, séparés par les espaces blancs des pauses, le roman est traversé, dans sa structure, par des échos intérieurs, une sorte d’ondes — de telle sorte que chaque action dérive du fragment précédent —, centrées également sur la question de la voix, à commencer par l’annonce de la mort de Simon à ses parents et à sa compagne, Juliette, une annonce qui déchire la continuité du temps. Par une écriture imprégnée du lexique de la médecine, tout comme Naissance s’approprie le langage technique de l’ingénierie ou comme Kiruna11 qui exploite dans un lexique approprié l’une des plus grandes mines encore en activité tout en dressant le portrait d’hommes et plus particulièrement de femmes qui ont marqué ensemble l’histoire de ce lieu, Réparer les vivants avance par la force et l’intensité dans un présent où seuls l’ensemble et la chorégraphie synchronisée capturés en direct comptent — « On entend leurs cœurs qui pompent ensemble la vie qui reste » (RLV : 199).
… à l’écriture vocale
11La prose de M. de Kerangal est souvent une découverte de l’humanité, de héros décelés tantôt dans leur singularité de sujet, tantôt dans le cadre d’une collectivité, pour nous faire percevoir un « rapport au monde conçu non plus en termes de possession mais en termes de mouvement, de déplacement, de trajectoire, autrement dit en termes d’expérience » (ASN : 44), tel qu’elle le remarque dans son ouvrage À ce stade la nuit12.
12Dans ce court texte, M. de Kerangal propose une lecture intertextuelle du drame des migrants à Lampedusa, en racontant, sans idéologie ni préjugé, les événements au gré de son imaginaire littéraire. En octobre 2013, plusieurs centaines de réfugiés venus de Lybie, se noient au large de cette île méditerranéenne : lorsque l’écrivaine entend à la radio cette nouvelle, le nom même de Lampedusa lui sollicite un parcours à travers plusieurs voix — « les voix que j’entends, leur intensité, leur fréquence » (ASN : 33), plusieurs textes ou plutôt plusieurs images — « À voix haute, le dos bien droit, redressée sur ma chaise et les mains bien à plat sur la table […], je prononce doucement : Lampedusa » (ASN : 39‑40).
13M. de Kerangal commence à examiner ce nom qui « résonne entre les murs, stagne, s’infiltre » (ASN : 10), elle l’analyse, le dissèque, « ce nom qui est déjà un récit » (ASN : 30). D’emblée les mots s’entrechoquent et la voix qui habite ce livre commence à dériver, elle aussi, « d’un nom à l’autre » (ASN : 33). La migration dont il est question dans ce texte concerne également le nom, Lampedusa, qui lui évoque « le nom […] de Burt Lancaster, celui d’un prince, celui d’un monde qui sombre » (ASN : 73), comme s’il s’agissait d’un naufrage ; c’est désormais un nom « concentrant en lui seul la honte et la révolte, le chagrin, désignant un état du monde, un tout autre récit » (ASN : 74), métaphore de la violence du monde contemporain.
14L’écrivaine essaie de sortir ce mot du bombardement médiatique dans un but littéraire. Donc, à travers un travail de creusement et d’exploration de la langue, elle amorce un parcours autour du mot, s’en éloignant et s’en rapprochant, en en faisant l’objet d’une rêverie — « J’ai divagué sur un chant qui décrirait, énumérerait, ramasserait toutes les songlines en une seule forme, ce chant du monde » (ASN : 45‑46). Ce qui fait qu’après avoir écouté la nouvelle du naufrage à la radio, le texte se développe selon parcours digressif et associatif par lequel du souvenir de B. Lancaster, le prince Salina du Guépard13, on passe à Bruce Chatwin et à ses songlines, voire à la mythologie des aborigènes australiens, découverte au cours d’un voyage en Sibérie.
15De par une écriture précise, fine et documentée, M. de Kerangal met en scène le flot d’informations radio et les images intimes qu’elles font dévoiler. À ce stade de la nuit est ce « chant du monde » qui « transforme [une simple] cuisine en chambre d’écho […] soudain, une voix comme une boule de feu affole la cuisine, elle est archaïque et déplacée, vergogna, vergogna ! » (ASN : 52 et 60). Entre travail de toponymie, enquête ethnographique, précision documentaire et écriture qui invente sa propre documentation, ce texte, à la lisière entre les données concrètement observées et l’invention du monde narré, entre le mot comme signe et le mot comme métaphore, montre le vaste horizon d’une altérité humaine et culturelle — « ce rire qui pulvérisait la bienséance d’une société pétrifiée, cassait l’ordre social comme un son trop aigu brise un verre de cristal » (ASN : 23), se faisant voyage dans les résonances produites par l’annonce d’un naufrage de migrants tout en échappant aux catégories des canons du roman traditionnel au profit d’une sorte d’ « observation participative » — « Elle demande au monde entier de venir voir, de venir voir ce qui se passe ici, à Lampedusa » (ASN : 60). Au‑delà de la restitution du réel, ce texte se fait porteur d’une expérience d’écriture : « expérience intime du paysage », à la fois évocation intime et universelle de l’écho qu’opère en nous l’actualité.
16Huit textes brefs, dont certains déjà publiés, d’autres inédits, organisés autour d’une novella, Mustang, autant de voix de femmes qui affleurent à chacune de ces histoires, composent le dernier ouvrage de M.d.K., un roman « en pièces détachées, une oscillation entre les genres littéraires » — tel qu’elle même le définit lors d’un entretien14 — qui sonde la voix humaine, sa texture, son intensité et son pouvoir de nous influencer ainsi que des situations clés de l’existence, l’amour, l’amitié, la peur du changement, la fragilité de la vie. « Les voix se sont trouvées filtrées, parasitées, voilées : leurs vibrations se sont modifiées et un ensemble de récits a pris forme15 », remarque l’écrivaine au sujet de ce recueil traversé par l’ambivalence de la voix : celle qui sort de la bouche du locuteur et celle qui est perçue par l’auditeur. À côté des canoës, plusieurs motifs reviennent sous forme d’échos et variations — des flèches, des ossements, des oiseaux —, ainsi que des voix — un timbre acidulé, des hurlements, des paroles surgies d’outre‑tombe —, pour relier ce qui semble comme disjoint, « tisser des liens entre les vivants et les morts » (C : 126) et dessiner ce roman en morceaux de femmes à la dérive cherchant leur voie à travers des voix humaines.
17Une série de portraits de femmes — mère ou fille, amie, compagne ou sœur — surgissent en quête de leur propre voix, instrument de leur accomplissement et, parfois, de leur libération, des voix qui changent et qui peuvent menacer une amitié ou un amour, des voix qu’on enregistre et qui portent les traumas du passé, des voix éteintes mais que l’on garde précieusement sur un répondeur, des voix qui hésitent, qui trébuchent et qui trahissent autant de fêlures, des voix à la recherche de leurs propre « petite voix ». Dans « l’histoire centrale », qui se déroule aux États‑Unis, il est question d’une mère exilée dans le Colorado avec son mari et son fils, en deuil de l’enfant qu’elle attendait, qui tente de retrouver sa voie au volant d’une voiture, une Ford Mustang, au son de son autoradio — « Si je baisse le volume, je perçois alors ma propre voix, furtive mais incroyablement nette, elle me revient et insiste, comme si ces heures seule en voiture ne m’avaient servi qu’à ça : l’entendre » (C : 92). Mais on y entend aussi toutes les voix collectionnées par les sœurs Klang tel des « pures matières acoustiques : elles sont basses ou aiguës, claires ou sombres, grasseyantes ou limpides, grumeleuses ou sifflantes […] » (C : 109), ou encore, la voix d’un garçon bégayeur qui essaie malgré tout de féliciter sa sœur bachelière.
18Au fil des différents récits de ce roman polyphonique, on découvre des voix dont M.d.K. a voulu « capter la fréquence » — « Une tout autre relation se joue entre moi et le monde. Je crois que j’essaie de capter une fréquence » (C : 67), avoue l’héroïne de Mustang, qui ne reconnaît plus rien, même pas le timbre de son compagnon lorsqu’il parle dans une langue autre que la sienne — « Je ne reconnait plus la voix de Sam […] quand Sam dans mon dos s’adresse à ceux d’ici, il m’arrive de me retourner pour m’assurer que c’est bien lui qui s’exprime là » (C : 49 et 50). Mais c’est surtout sa voix, la voix de l’écrivaine qui émerge en filigrane, « l’occasion d’entendre [sa] propre voix » (C : 109), voix « qui se cherche dans tout ce qui est multiple16 » et qui raconte les vestiges, les reliefs, les traces, l’infiniment petit qui fait une existence de par son écriture, un tissu sonore sensible aux variations de l’être, capable de faire résonner chacun de ses mots : la petite voix de son moi, « un “je”, au plus proche » tel que le souligne l’écrivaine elle-même.
19L’image du canoë traverse chaque texte, sous une forme ou une autre, à la fois figure itérative traversant les histoires, qui nous promène d’une histoire à l’autre, d’une voix à une autre, et ancien motif totémique abritant le propos existentiel du recueil qui puise dans ces voix singulières ainsi que dans les silences « épais », ces « apnées collectives » (149), pour atteindre les ressorts cachés de nos existences, la force vitale des mots et des silences, le courage et les doutes des voix qui les portent, nous faisant naviguer dans cette promenade vocale.
Échos et variations
20« Paysage sonore », « chant de la réparation », « chant du monde », sons d’un temps révolu, de Corniche Kennedy à Canoës, en passant par Naissance d’un pont, Réparer les vivants et À ce stade de la nuit, l’écriture de M.d.K. révèle une choralité humaine alliant la précision technique et l’emphase lyrique à l’intensité des sentiments qui animent les voix de chaque personnage.
21Il s’agit là d’une écriture qui capte en direct sons et voix comme ce « crescendo de voix politiques […] des voix italiennes, métalliques, saturées de sentiments [qui] vibrent sous celles, plates, des interprètes » (ASN : 29) à propos de Lampedusa ou cette inédite bande son visuel qui pointe le verbe et l’onomatopée dans Corniche :
On les entend venir de loin, lancés sur leur bolide, ils ralentissent dans le virage, accélèrent en fin de courbe, blindent sur cinquante mètres, freinent à mort à hauteur du panneau, alors dérapage contrôlé, pneus qui crissent, hop sur le trottoir, vroum, vroum […] le bruit de leurs baskets résonne sur les rochers, bam, bam, lentement, puis de plus en plus rapide. (CK : 12 et 13).
22De même que dans À ce stade de la nuit M.d.K. se met à l’écoute du « bruit des moteurs, ce bourdonnement régulier mélangé à celui de la mer […] à celui de la radio » (ASN : 69), dans Réparer les vivants les vagues de l’océan se font lignes sonores qui traversent le réel apportant avec elle toutes sortes de sons, attribuant à la phrase une concrétude physique et poétique insoupçonnée. Transmise à travers la dimension sonore, la fiction renvoie un aperçu de la vie, au‑delà de la mort, du langage vivant des corps à travers une écriture en devenir pour aboutir à un « paysage sonore » insolite, fait d’échos et de variations autour de cette humanité qui est la nôtre.
—
23Dans un entretien M.d.K considérait Réparer les vivants « plus un livre de l’oreille que de l’œil. C’est un livre qui s’écoute17 », dans À ce stade, elle écrit « j’ai vu le roman dans la songline […] pour écrire, j’ai pensé qu’il fallait capter ce chant qui subsistait d’un temps où le livre n’existait que sous sa forme chantée » (ASN : 46). Enfin, dans Canoës, M.d.K. concerte neuf textes — que l’on écoute autant qu’on les lit — dans le but de « sonder la nature de la voix humaine […] et composer une sorte de monde vocal » tel que le récite la quatrième de couverture, donnant également la voix à son propre “je” parmi tous les autres. Abordant la matière de ses sujets avec une langue très travaillée, rapide, sonore, avec des effets de heurt, précise — par l’exploration de tous les champs lexicaux propres à chaque sujet — qui donne à ses récits une rigueur exemplaire, captant et retranscrivant les sensations, les perceptions, volontiers collectives, de ses personnages, ne serait-ce que l’écriture saisit un flux physique, mental et verbal, en créant la lumière, la scène, les sensations, la parole elle-même ainsi que cette « fréquence » tout le temps partagée et plurielle que l’écrivaine essaie de capter depuis Ni fleurs ni couronnes18 ?