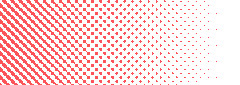Bande dessinée, blog BD et dessin animé chez Benjamin Renner : variantes narratives et graphiques
1Le Grand Méchant Renard et autres contes (Benjamin Renner et Patrick Imbert, 2017) est un film d’animation composé de trois segments qui mettent en scène des personnages et des lieux récurrents –une bande d’animaux vivant dans une ferme et dans la forêt qui l’entoure. Ces trois récits, Un bébé à livrer, Le Grand Méchant Renard et Il faut sauver Noël ! sont adaptés de bandes dessinées de Benjamin Renner, l’un des coréalisateurs du film.
2Un bébé à livrer, qui raconte l’histoire d’un bébé confié par une cigogne blessée à un lapin, un canard et un cochon, afin qu’ils le « livrent » à sa famille, avait initialement été publié comme un feuilleton sur le blog de l’auteur sous le titre Le Cochon, le Canard, le Lapin et le Bébé (cinquante épisodes entre 2008 et 2009). Cette bande dessinée fut ensuite éditée sous forme d’album, prenant le titre Un bébé à livrer (Warum/Vraoum !, 2011, 22,9x19 cm, 300 pages). Si elle n’engendre pas de modification du contenu narratif, la remédiatisation1 de la bande dessinée du blog vers l’album implique de profondes reconfigurations de format, de support et de lecture (une consultation sur écran ou sur papier, un récit découpé en épisodes ou continu, des vignettes alignées verticalement ou disposées sur une page de papier…).
3La bande dessinée dont est adapté le segment Il faut sauver Noël ! a également connu une première publication en feuilleton sur le blog (dix-neuf épisodes entre décembre 2014 et janvier 2015). Ce récit se situe dès son titre, Le Canard, le Cochon, le Lapin et le Père Noël, dans la continuité de la première bande dessinée et reprend le même univers avec une nouvelle aventure : le canard et le lapin, persuadés d’avoir tué le Père Noël, se mettent en tête de le remplacer avec l’aide du cochon.
4Le Grand Méchant Renard se déroule quant à lui entre la ferme et la forêt qui l’entoure, et fait cette fois intervenir, en plus du cochon, du lapin et du canard, les poules ainsi que deux personnages peu ou pas présents dans les autres récits, un loup menaçant et un renard un peu ridicule. Ce dernier, parvenu à voler des œufs pour les manger, se retrouve malgré lui à vivre avec les trois poussins qui en sont sortis et l’ont pris pour leur maman. Contrairement aux deux autres bandes dessinées, Le Grand Méchant Renard paraît d’emblée en tant qu’album (Delcourt, coll. Shampooing, 2015, 16,5x23 cm, 192 pages). Quelques mois plus tard, l’album est réédité en incluant en seconde partie Le Canard, le Cochon, le Lapin et le Père Noël, qui prend le titre Il faut sauver Noël ! (Delcourt, coll. Shampooing, 2015, 251 pages). La publication du Grand Méchant Renard est aussi accompagnée de deux autres productions créées par l’auteur lui-même : une courte animation mise en ligne sur YouTube2 qui montre une scène non présente dans l’album dans laquelle les trois poussins jouent à la corde à sauter avec la queue du renard, et une bande dessinée numérique interactive publiée sur le site T, le portail turbomedia3, qui reprend ce qui pourrait s’apparenter aux prémices du récit – le renard tente par tous les moyens de s’introduire dans la ferme – et dont la progression se fait grâce à des options choisies par le lecteur. Ces objets forment un véritable réseau narratif transmédial (Jenkins, 2006), en ceci que les personnages, récits et lieux sont, dès leur conception, imaginés pour exister sur plusieurs supports médiatiques. Si le phénomène se situe ici dans le contexte d’une production « d’auteur » plutôt qu’au sein de mécanismes de grandes franchises, il n’en reste pas moins exemplaire des possibilités de déclinaisons médiatiques d’un univers diégétique.
5Ces trois récits principaux peuvent être considérés comme des variantes narratives d’une même diégèse, mais aussi comme des variantes médiatiques, chaque récit existant à travers plusieurs modalités médiatiques et matérielles distinctes. À ces deux niveaux de variation s’ajoute une composante graphique, puisque toutes les productions sont des œuvres qui reposent sur des représentations dessinées qui sont produites, diffusées et reçues de diverses façons selon les œuvres. Par exemple, pour les bandes dessinées, les images sont envisagées comme une suite de poses fixes ; le dessin est réalisé sur papier par une seule personne, puis est scanné et éventuellement imprimé pour être lu dans un livre, ou mis en ligne pour être consulté sur un écran d’ordinateur. En revanche, pour le film d’animation, les dessins ont été faits sur tablette par une équipe d’animateurs, et leur mise en série donne l’illusion d’un dessin en mouvement. Cet exemple fait apparaître l’une des caractéristiques récurrentes de ces variantes, à savoir la présence du numérique, dont j’étudierai ici les implications au sein des trois niveaux mentionnés (narratif, médiatique et graphique).
6Dans cet article, je propose d’analyser le phénomène multidimensionnel de « variance » à l’œuvre dans ce cas d’étude, et de montrer en quoi les variantes permettent de déployer conjointement un univers narratif, un réseau médiatique, et des possibilités graphiques. Plus particulièrement, l’étude des variantes et des transferts d’une œuvre ou d’un support à l’autre sera l’occasion d’examiner la place des technologies numériques dans la création, la circulation et la réception des œuvres.
7J’analyserai tour à tour les trois principales modalités de transfert et de relation – remédiatisation, adaptation et transmédialité – en m’attachant à chaque fois aux aspects narratif, médiatique et graphique, et à leur articulation, et en insistant en particulier sur la place du numérique.
La bande dessinée, du blog à l’album
8En 2008, Benjamin Renner ouvre un blog sur le site français de création et d’hébergement de blogs Canalblog (créé en 2003), et commence à y publier Le Cochon, le Canard, le Lapin et le Bébé, un récit-feuilleton en bande dessinée, dont chaque épisode correspond à une mésaventure d’un cochon, d’un canard et d’un lapin, qui tentent d’amener un bébé abandonné par une cigogne à ses parents. Ce site personnel s’inscrit tout à fait dans l’air du temps puisqu’à cette époque, de nombreux dessinateurs diffusent leur travail via un blog4. Renner, qui vient d’achever des études aux Beaux-Arts, puis dans une école d’animation, n’est alors pas un auteur professionnel. Cette publication se fait en parallèle d’un projet rémunéré dans un autre champ : un long-métrage d’animation qui sortira en 2012, Ernest et Célestine (coréalisé avec Stéphane Aubier et Vincent Patar). Le Cochon, le Canard, le Lapin et le Bébé est d’ailleurs initialement destiné au cadre familial, en particulier au frère de Renner, sur le point de devenir père. Sa création s’inscrit dans le contexte des blogs BD des années 2000 (Baudry, 2018 et Trédan, 2015) : des sites hébergeurs en accès gratuit comme Canalblog attirent des amateurs ou jeunes artistes dont cette pratique s’inscrit « dans le cadre d’une sorte de “temps libre”, entre deux projets rémunérés ailleurs » (Kovaliv, 2022, § 1). Cette décennie voit le nombre et la notoriété de ce type de sites augmenter, comme en témoigne le concours « Révélation blog » créé en 2008 par le festival de bande dessinée d’Angoulême, et pour lequel est sélectionné le blog de Benjamin Renner en 2009. En phase avec les usages propres aux blogs, qui, comme l’écrit Olivier Trédan (2015), « prennent généralement l’allure de carnets de bord personnels où se mêlent des dessins et de courts billets centrés sur le quotidien de l’auteur » (p. 170), Renner insère souvent, entre les épisodes, des publications qui présentent le travail d’autres artistes (souvent aussi blogueurs) ou renseignent les lecteurs sur l’avenir du feuilleton. L’artiste ne cache pas que la publication se fait au fur et à mesure de la création, commente les délais entre deux épisodes et plaisante avec le fait que lui-même ne connaît pas la suite de l’histoire. Par exemple, le 9 janvier 2009, il publie un post intitulé « En retard !!! » où il s’excuse auprès de ses lecteurs pour la longue pause qui a suivi le dernier épisode paru, dans lequel il inclut une vignette montrant le récit là où il l’a interrompu (le cochon se retrouve pris comme ballon dans un match de foot) avec une blague autoréflexive : le canard et le lapin, qui observent la scène, crient au pauvre cochon « Y a Reineke [pseudonyme de Benjamin Renner] qui nous charge de te dire qu’il te sort de là dans une semaine ! »5 Un lien permet ensuite de revenir au premier épisode du récit, ce que l’auteur fait régulièrement tout au long de la publication. En effet, ainsi que le rappelle Sébastien Rouquette (2009), le blog impose « une double contrainte de forme. Les dessins y sont nécessairement mis en page sous forme de billets et les billets sont présentés de manière antéchronologique » (p. 119). Commencer la lecture d’un feuilleton en cours de route nécessite donc de remonter le fil des publications afin de retrouver le début du récit – sauf si l’auteur, comme dans le cas présent, utilise des liens hypertextes pour rediriger plus aisément les internautes.
9L’intérêt de lire le blog « en temps réel » réside en outre dans l’immédiateté de la relation entre l’auteur et son lectorat, propre à ce type de diffusion : déjà évoquée avec le souci de l’auteur de ne pas laisser ses lecteurs sans nouvelles, la proximité entre l’artiste et son public s’exprime également dans les commentaires laissés par les lecteurs à la suite des publications, et par la possibilité de l’auteur de leur répondre. Comme le souligne Julien Baudry (2018), ce « contact [est] consubstantiel au fonctionnement du Web social où les commentaires des lecteurs peuvent influencer les publications » (p. 140). Un exemple met en évidence cette possibilité de prise en compte des attentes et réflexions des lecteurs par Renner : ce dernier débute son post du 14 octobre 2009 par une réponse à des commentaires reçus sur l’épisode précédent du feuilleton, les lecteurs lui ayant fait remarquer une incohérence narrative (les personnages allaient poster un colis sans avoir besoin de payer l’envoi). Expliquant que ceci était dû à un passage retiré pour des raisons « morales » (les animaux volaient le porte-monnaie d’une vieille dame pour payer, et Renner dit avoir eu rétrospectivement pitié de ce personnage, d’où la suppression des vignettes), l’auteur révèle l’extrait en question, puis ajoute : « À présent, je fais appel à vous... Je vous propose de voter pour que je sache si je dois réintégrer l’extrait dans le récit ou l'oublier à jamais dans les limbes de l’autocensure. »6 Cette anecdote éclaire le lien entre processus de création et modalités de lecture : les lecteurs sont appelés à participer rétrospectivement à la construction du récit. Plus largement, le feuilleton reposant sur la fidélité du lectorat, l’auteur est tenu de proposer des épisodes « entre autonomie et continuité » (Revaz, 2016, p. 44) qui doivent à la fois répondre aux attentes amenées par le précédent épisode, présenter un intérêt propre, et susciter de nouvelles perspectives pour générer l’envie d’attendre et de lire l’épisode suivant.
10En effet, chaque épisode se termine par une chute, soit en suscitant un suspense qui se trouve résolu à l’épisode suivant (l’épisode 37 se clôt par la chute de l’avion du bébé et des trois héros ; l’épisode 38 reprend exactement là où le récit s’était arrêté, et les personnages parviennent à fabriquer un parachute), soit en constituant une ponctuation suivie d’une ellipse (l’épisode 12 s’achève avec le lapin qui revient, le visage tuméfié, d’un champ où il a confondu une vache avec un taureau ; l’épisode 13 commence directement avec les trois héros – le lapin à nouveau indemne – aux côtés d’une gentille vache qu’ils voudraient traire pour donner du lait au bébé).7 Ainsi, le récit prend la forme d’une suite d’aventures plus ou moins contiguës dans le temps diégétique et lues de façon fragmentée, la création et la publication s’étant échelonnées sur plus d’un an et cinquante épisodes.
11À la fin de l’épisode 36, Benjamin Renner ajoute un petit texte en réponse à des commentaires de lecteurs l’interrogeant sur la possibilité d’une future édition papier de la bande dessinée, mentionnant que « la question a été évoquée »8. En 2011, sort l’album Un bébé à livrer, adapté de Le Cochon, le Canard, le Lapin et le Bébé. Cette publication ne résulte pas d’un phénomène isolé, puisque, comme l’explique Baudry (2018), « “[l]’adaptation de blog bd” devient un genre éditorial à part entière » (p. 127) à partir du milieu des années 2000, porté par quelques éditions dont Warum/Vraoum !9, qui publie Un bébé à livrer, mais aussi la collection Shampooing de Delcourt, dirigée par Lewis Trondheim – qui compte parmi les premiers auteurs professionnels de bande dessinée à avoir investi le web – où ont été publiés Le Grand Méchant Renard, Il faut sauver Noël ! et la réédition d’Un bébé à livrer (2018). Outre le fait que ce phénomène soit révélateur des mutations entraînées par le numérique dans le paysage de la bande dessinée, la publication d’un album à partir d’un blog est considérée par les auteurs comme « le moyen d’obtenir une légitimité quant à leur place dans le champ de la bande dessinée » (Kovaliv, 2022, § 16), et peut être comprise, dans notre cas, comme un signe de la professionnalisation de Benjamin Renner en tant que bédéaste. La publication en album d’une bande dessinée issue du web lui assure aussi une pérennité, la conservation et l’accessibilité des bandes dessinées numériques posant en effet problème à long terme10.
12Pour Un bébé à livrer, les adaptations du récit liées à sa remédiation du blog vers l’album concernent avant tout son format. Les épisodes sont mis à bout-à-bout, sans chapitrage, mais sans modification du contenu narratif. Alors que sur le blog, les cases sont disposées verticalement et lues grâce au défilement de la page web opéré par le lecteur, à la manière d’un webtoon11, chaque page de l’album comprend trois ou quatre vignettes disposées sur deux lignes : la ponctuation ne correspond plus à la fin de l’épisode, mais à l’action de tourner la page. Or, les épisodes du feuilleton initial sont de longueur très variable, entre cinq et quarante-cinq vignettes environ, ce qui peut contribuer à expliquer que les ponctuations dans l’album ont tendance à moins bien fonctionner. De l’aveu même de Renner, qui explique qu’« Un bébé à livrer n’était […] fait que pour être sur le blog » et qui considère le livre comme « assez mauvais dans sa mise en page »12, l’album ne semble ici pas être un support médiatique en adéquation avec le format du feuilleton issu du blog. La structure d’un récit construit pour être lu en épisodes est en effet susceptible de moins bien fonctionner dans un format en « one shot », ainsi que le notent Baroni, Kovaliv et Stucky (2021) : « [l]es effets recherchés par les pratiques de narration en feuilleton se trouvent parfois neutralisés par la forme continue et clôturée de l’album » (§ 7).
13Fort de cette expérience, Renner a d’emblée conçu sa bande dessinée suivante, Le Canard, le Cochon, le Lapin et le Père Noël (également d’abord publiée sur le blog) avec l’idée qu’elle puisse un jour être un album. Il a créé la totalité du récit avant sa mise en ligne, qui s’est déroulée sur un temps beaucoup plus restreint (dix-neuf épisodes publiés en un mois). Imaginer un récit déclinable sur plusieurs supports médiatiques a permis de mettre en place une structure narrative appropriée à la fois au feuilleton (une suite de petites aventures vécues par les trois personnages qui essaient de remplacer le Père Noël) et à l’album, pour un récit à lire en continu. De fait, le cadre temporel est plus clair et resserré (l’histoire se déroule la veille et la nuit de Noël, tandis que les marqueurs temporels de Le Cochon, le Canard, le Lapin et le Bébé sont plus flous, voire inexistants), les aventures sont moins nombreuses que dans le précédent récit et s’enchaînent avec plus de fluidité et de logique, et on peut distinguer une organisation narrative proche d’une structure en trois actes.
14L’étude de ces variantes et la différence dans les processus de remédiatisation – un transfert rétrospectif ou planifié – ont permis de mettre en évidence l’influence réciproque entre narration, format du récit, support de diffusion, modalités de lecture, et relation entre auteur et lecteurs. Toutefois, si le support de diffusion est crucial à plusieurs égards pour comprendre les enjeux de création et de narration, l’œuvre connaît en fait, au cours de sa genèse, une succession de supports.
D’un support à l’autre
15Un album de bande dessinée présente la particularité de se situer entre le manuscrit et l’imprimé, dans le sens où, dans le cas d’artistes comme Benjamin Renner qui créent sur papier et non directement en format numérique, c’est le manuscrit original qui est scanné puis imprimé. Ainsi, si les supports de création et de diffusion sont semblables – il s’agit de papier dans les deux cas –, l’œuvre est entre-temps scannée et passe par une étape numérique, ce qui n’est pas sans conséquence.
16Le processus du scan fait subir à l’œuvre un ensemble de transformations. S’il transpose des caractéristiques propres à la création sur papier (comme les plis de la feuille dus à l’aquarelle qui l’a fait gondoler), il crée également de nouvelles imperfections (par exemple en capturant indifféremment le papier et les éventuelles poussières localisées sur la feuille ou sur le scanner, ces artefacts faisant ensuite partie de l’image numérisée), et altère certains aspects du dessin, notamment l’éclat des couleurs et la blancheur du fond. Afin d’obtenir une version numérique « améliorée » du dessin sur papier, Renner utilise un logiciel de retouche d’images pour effacer les artéfacts inhérents au papier (les plis) et au scan (les poussières), et restituer les couleurs d’origine et le blanc de la feuille.
17Au niveau du texte, les outils numériques sont utilisés par Benjamin Renner dans le but de recréer un rendu artisanal, par le biais d’une procédure singulière élaborée pour Le Grand Méchant Renard. Jugeant les polices d’écriture numérique trop froides et impersonnelles – à l’instar de nombreux autres auteurs de bande dessinées – mais souhaitant optimiser sa création en évitant le risque d’oubli de mot ou de fautes d’orthographe, Renner élabore une police numérique à partir de sa propre écriture manuscrite. Les textes sont tapés à l’ordinateur avec cette police « manuscrite », puis imprimés et décalqués à la main sur une autre feuille (à l’exception des onomatopées, qui sont directement écrites à la main au sein du dessin). Ce système permet d’allier une certaine sécurité (une erreur peut être facilement modifiée) et de préserver ce que Laurent Gerbier (2017) appelle « la singularité d’une main ». Le décalquage du texte offre en outre la possibilité de particulariser non seulement chaque lettre (dont les inflexions seront uniques), mais aussi des phrases ou morceaux de phrase pour leur conférer une plus grande expressivité, par exemple en jouant sur la taille de la police, qui devient de plus en plus petite pour signifier un marmonnement gêné.
18Renner explique d’ailleurs lui-même ce choix comme fruit d’une recherche d’équilibre entre, d’une part, lisibilité et harmonie, et, d’autre part, ressenti artisanal et trace du geste manuel dans son imperfection :
Je n’aime pas trop quand on sent qu’il y a une police. Et puis ma police n’est pas très belle, donc je voulais qu’il y ait un côté un peu bringuebalant, ce qui fait que j’ai tout redessiné à la main, pour qu’il y ait un côté manuel.13
19L’utilisation par l’artiste du verbe « dessiner » pour se référer à la réécriture du texte est signifiante : image et texte sont conçus comme un tout. Malgré les différences au sein de leur création respective (le dessin étant créé à la main sur papier), texte et image apparaissent homogènes. Ils présentent en effet tous deux un trait simple, expressif, fin, anguleux et un peu irrégulier, qui contribue à conférer une cohésion globale à la vignette. À cela s’ajoute l’absence de cadre délimité aux cases, qui rappelle l’absence de bulle autour des dialogues. Cette harmonie fait écho aux propos de Gerbier (2017), qui considère que le lettrage (l’écriture des textes en bande dessinée) « réalise la coexistence du lisible et du visible » et « paraît marquer la réconciliation manuscrite du texte et de l’image, que l’âge de l’imprimé avait séparés ». L’exemple du Grand Méchant Renard donne à voir une façon de « réconcilier » texte et image dans un environnement de création hybride, entre techniques manuelles et numériques, entre support papier et numérique.
20L’étude des phénomènes de remédiatisation dans le cadre des bandes dessinées de Benjamin Renner – qui concernent à la fois les œuvres (du blog vers l’album) et les techniques (remédiatisation des techniques et des esthétiques artisanales par un recours à des outils numériques) – a montré en quoi le format du récit, les supports de diffusion, et les modalités de lecture jouent un rôle majeur au niveau des choix créatifs. En revanche, comme l’écrit Baudry (2020), « la bande dessinée présente le cas d’un média où la transition numérique n’intervient pas avec la même intensité en fonction de l’étape considérée » (p. 68). L’examen des œuvres, de leur genèse et du passage d’une variante à l’autre a en effet permis de nuancer les potentielles associations linéaires entre un médium et un type de support, pour plutôt appréhender les œuvres comme des palimpsestes qui portent en eux des techniques et supports variés. Ainsi, les bandes dessinées diffusées sur le blog ne sont pas des œuvres purement numériques puisqu’elles ont été créées sur papier, tout comme les albums ne sont pas des productions séparées de toute influence numérique, parce que leur contenu provient du web dans le cas d’Un bébé à livrer et Il faut sauver Noël !, ou parce que, pour Le Grand Méchant Renard, la création a combiné un ensemble de supports et d’outils numériques ou non.
L’adaptation filmique de bandes dessinées : variantes narratives et de mise en scène
21L’autre modalité de variante essentielle dans l’œuvre de Benjamin Renner est l’adaptation des bandes dessinées en film d’animation. En reprenant la proposition souvent citée de Linda Hutcheon (2006, p 7) d’étudier l’adaptation dans les deux sens du terme (comme « process » et comme « product ») et en m’attachant aux différentes implications du mot « process » (autant le processus de passage d’une œuvre à l’autre que le processus de fabrication des œuvres), j’envisagerai, dans mon analyse, à la fois les œuvres en tant que telles, le passage de l’une à l’autre, et les étapes et modalités de création.
22Au-delà de l’origine technique commune des productions de Renner – le dessin –, on constate d’emblée une forte homogénéité esthétique qui traverse les bandes dessinées et le film. Même si cette continuité peut avant tout s’expliquer par le fait que la même personne est à l’origine des œuvres adaptées et de l’adaptation, l’artiste explique avoir consciemment envisagé la conception de l’œuvre filmique dans la continuité des méthodes mises en place pour la bande dessinée :
La méthodologie que j’utilise pour écrire le film est exactement la même que j’utilise pour faire de la bande dessinée. […] j’ai un truc très précis en tête, j’ai la scène qui se déroule et je la traduis d’abord sur papier. Alors qu’en bande dessinée, j’arrête au moment du papier, en animation, c’est l’étape du storyboard qui deviendra plus tard le film.14
23La mise en exergue de cette proximité technique ne signifie pas pour autant que le film représenterait l’aboutissement de la bande dessinée avec l’accomplissement d’un mouvement qui n’était que suggéré. Renner justifie en fait cette différence technique par des raisons avant tout narratives et de mise en scène :
J’ai remarqué que quand j’essayais [en bande dessinée] de faire un truc qui se rapprochait de l’animation, je trouvais que ce n’était pas très efficace, la comédie ne partait pas super bien. […] C’est beaucoup plus dans le dialogue que je m’éclate. […] Il y a un petit côté très théâtre de boulevard, j’aime bien ce côté où c’est très simple, c’est vraiment sur les dialogues. 15
24En effet, le film comporte une plus grande variété d’échelles de plans et de points de vue que la bande dessinée, où il n’y a quasiment aucun gros plan ni champ-contrechamp, mais où les personnages sont presque toujours montrés côte à côte, en plan moyen. La bande dessinée est aussi plus bavarde que le film, dans lequel beaucoup des gags de dialogue ont été adaptés pour un public plus jeune, ou même supprimés : par exemple, dans Le Grand Méchant Renard, lorsque le renard se déguise en poule pour séjourner à la ferme avec les poussins, il s’attire, dans la bande dessinée, des remarques suspicieuses d’une poule au sujet de son apparence étrange (« Et vous venez d’où, comme ça ? De l’Est ? Du côté de Tchernobyl ? », p. 139), dialogue que le film ne reprend pas pour simplement montrer le regard méfiant de la poule. Les récits ont parfois connu d’importantes transformations narratives au cours de l’adaptation. Faisant écho aux remarques précédemment faites au sujet d’Un bébé à livrer, le producteur du film Didier Brunner explique :
Au départ Un bébé à livrer était une série de sketchs amusants mais sans véritable rigueur dramaturgique : les gags s’ajoutaient les uns aux autres pour raconter l’histoire. Le travail d’adaptation a consisté à la transformer en une vraie fable qui raconte comment les meilleures intentions peuvent engendrer des catastrophes si on ne réfléchit pas bien à ce que l’on fait.16
25L’adaptation d’Il faut sauver Noël ! modifie quant à elle l’un des fondements du récit originel : dans la bande dessinée, le personnage du Père Noël n’existe pas, et le cochon s’évertue tout au long de l’histoire à prouver à ses deux compères qu’il s’agit d’un mythe ; en revanche, le film, destiné aux spectateurs dès leur plus jeune âge, met en scène le « vrai » Père Noël, attestant de son existence.
26Le film tire aussi davantage profit des possibilités sonores et visuelles propres à son médium, comme dans la scène du Grand Méchant Renard où le renard raconte une histoire aux poussins dans le but de les endormir : alors que le conte est uniquement raconté à travers le dialogue dans la bande dessinée, le film propose une illustration visuelle des paroles du renard, avec une animation de silhouettes blanches sur fond sombre accompagnée de musique et d’effets sonores provenant du récit enchâssé.
27Le début, la fin et les « intermèdes » entre les trois segments du film jouent quant à eux avec les codes médiatiques du théâtre : un rideau s’ouvre sur un décor peint à la main, et les personnages récurrents des trois segments sont présentés comme étant une troupe de théâtre qui interprète des pièces – bien que le dispositif théâtral et la dimension réflexive disparaissent dans les trois courts-métrages. La mise en scène de ces passages rappelle celle de la bande dessinée : un plan fixe montre l’ensemble de la scène où parlent et circulent les personnages.
Reconfiguration technique et imitation esthétique
28Outre des modifications narratives et de mise en scène, de nombreux aspects d’ordre technique sont à prendre en considération pour comprendre les enjeux de l’adaptation des bandes dessinées en un film d’animation, en particulier l’impression de continuité qui se dégage des œuvres malgré de fortes disparités dans les processus de création.
29Si l’on compare une vignette issue d’une bande dessinée et son « équivalent » filmique, on reconnaît aisément les personnages et on distingue un style commun : même si la bande dessinée a une apparence un peu plus « brouillonne » que le film, l’ouverture et le lâché du trait sont en fait assez similaires. Le contour des personnages n’est qu’esquissé, et c’est la couleur qui vient donner du volume aux personnages. Or, cet élément caractéristique du dessin de Benjamin Renner n’a pas été évident à reproduire pour le film. Les raisons de cette difficulté résident autant dans le changement de support de création que dans les modalités de production. Tandis que la bande dessinée a été réalisée sur papier, le film a été fait sur tablette numérique, en utilisant le logiciel Adobe Animate (ex-Flash). De fait, alors que de nombreux bédéastes continuent à travailler sur papier, ce support a quasiment disparu de l’industrie du dessin animé pour des raisons principalement économiques et logistiques : un film d’animation nécessite une énorme quantité de dessins, bien supérieure à une bande dessinée, et le passage d’une étape à l’autre (lay-out, poses-clés, poses intermédiaires, traçage du trait définitif, colorisation, compositing…) dans un tel travail en équipe est facilité par le format numérique. Pour ses bandes dessinées, Renner a utilisé un feutre à pointe fine pour le trait et de l’aquarelle pour la couleur. Lors d’un dessin réalisé à la main sur papier, le trait a tendance à comporter de légères aspérités, qui peuvent être dues à l’outil lui-même (par exemple, à la disposition changeante des poils du pinceau lors du contact avec la feuille), à la matière appliquée (un trait aura une consistance différente si le dessinateur vient de tremper sa plume dans l’encre ou son pinceau dans la peinture, ou s’il ne reste plus beaucoup de substance sur l’outil), à des hésitations ou des irrégularités dans le geste, ou à la texture du papier qui joue sur la constance et l’apparence du trait et des couleurs. Sur une tablette graphique, l’outil et la surface sont parfaitement lisses, et la matière est régulière dans son application. Quant aux irrégularités du geste, elles peuvent être gommées grâce à l’activation d’une option proposée par l’interface d’Adobe Animate – « lissage du trait » – qui permet d’obtenir un trait régulier. Or, cette option n’aurait, selon Benjamin Renner, pas été utilisée pour le film, et les lignes ont conservé une apparence plus « brute ». Le trait rappelle ainsi le travail artisanal et reproduit une esthétique semblable à celle de la bande dessinée, malgré la perte de texture et d’aspérités pour les autres aspects cités précédemment, qui contribuent à expliquer la sensation d’un dessin plus léché dans le film (cf. Fig. 1).
Fig. 1 : Un trait « brut » et un trait « lissé » sur le logiciel Adobe Animate (démonstration de Benjamin Renner)
30Au niveau de la couleur, l’ouverture du trait (les contours des personnages et objets ne sont pas fermés, cf. Fig. 2) et le fait que toute une équipe – qui plus est, différente de celle des animateurs – ait la charge de cette étape posait tout à coup la question d’une interprétation commune des volumes. La spontanéité de la colorisation pratiquée instinctivement par Renner dans la bande dessinée nécessitait d’être conscientisée et explicitée.

Fig. 2. : Capture d’écran du lay-out du film Le Grand Méchant Renard (Benjamin Renner et Patrick Imbert, 2017), fourni par Benjamin Renner. Le dessin non colorisé montre bien le lâché du trait et l’ouverture des lignes.
31En outre, l’aquarelle offre un rendu visuel caractéristique, avec des taches aléatoires et des niveaux de transparence très nuancés qui sont difficiles à reproduire numériquement. Pour le film, une couleur mate a d’abord été utilisée sur le logiciel d’animation, puis un « effet aquarelle » – spécialement créé par des ingénieurs en informatique pour Ernest et Célestine, le film précédent de Benjamin Renner, également adapté d’albums graphiques colorés à l’aquarelle – a été appliqué pour transformer les couleurs et imiter le rendu papier de ce type de peinture. Les personnages s’intègrent ainsi de façon cohérente au sein des décors, qui ont quant à eux ont été réalisées avec de la véritable aquarelle sur un papier ensuite scanné. Le pourtour estompé des décors rappelle par ailleurs la bordure des vignettes (Fig. 3-4), bien que le film comporte des décors beaucoup plus sophistiqués que les bandes dessinées, qui n’en ont que très peu.
Fig. 3 : Vignette issue de la page 138 de l’album Le Grand Méchant Renard, de Benjamin Renner, qui donne à voir le minimalisme des décors et l’absence de case délimitée. © Éditions Delcourt - 2015
Fig. 4 : Capture d’écran du film Le Grand Méchant Renard (Benjamin Renner et Patrick Imbert, 2017). Les décors du film, bien plus élaborés que dans l’album, incluent des éléments narratifs comiques, comme ici la poupée vaudou à l’effigie du renard et l’attirail d’armes de la poule. Le pourtour estompé, dans les coins inférieurs, rappelle par ailleurs la bordure des vignettes de l’album.
32L’adaptation des modes de représentation à un nouveau langage médiatique s’accompagne donc d’une recherche de fidélité visuelle vis-à-vis de l’œuvre d’origine, et de reproduction d’une sensation « artisanale » que revendique Benjamin Renner lorsqu’il explique : « On essaie de voir ce qui crée la sensation de l’aquarelle, et de le reproduire pour retrouver le style [des bandes dessinées] »17. Les technologies numériques sont utilisées dans un rapport de continuité et d’imitation des techniques manuelles. Cet usage est révélateur d’un phénomène historique plus large décrit par Sara Álvarez Sarrat et María Lorenzo Hernández (2012) :
L’animation par ordinateur […] a ironiquement aidé à rehausser le profil des techniques pionnières d’animation artisanale, en particulier en reproduisant les outils dits « traditionnels » de dessin et de peinture et leur terminologie dans les logiciels d’infographie (p. 1, je traduis).
33Si, au cours de l’adaptation, les processus techniques sont reconfigurés à la fois pour le médium audiovisuel, la production en équipe, et la création avec des outils numériques, le résultat obtenu invisibilise ce transfert en offrant une continuité visuelle entre bandes dessinées et film, caractérisée entre autres par la sensation d’un travail artisanal.
Le réseau transmédial du Grand Méchant Renard : explorations narratives et graphiques
34L’idée de continuité est également centrale lorsque l’on examine les productions entourant la sortie de l’album Le Grand Méchant Renard : une animation YouTube de trente secondes et une bande dessinée numérique interactive, toutes deux réalisées par Benjamin Renner proposent des scènes inédites à l’album. Dans la séquence animée, le renard est suivi par les trois poussins, qui attrapent sa queue pour faire de la corde à sauter, puis lui sautent dans les bras en l’embrassant, alors qu’il tente vainement de se débarrasser d’eux. Réalisée avant le projet du film, la scène s’inscrit dans une esthétique plus proche de celle de la bande dessinée : les poussins sont par exemple des petites boules unicolores et indifférenciées, dont on ne distingue presque pas les pattes (alors que dans le film, deux poussins sont bicolores, ils ont de plus longues pattes, leur tête se distingue clairement de leur corps, et ils sont différents les uns des autres, notamment par la forme de leur tête et par leur taille) ; de plus, lorsque les poussins câlinent le renard, de petits cœurs apparaissent, comme des idéogrammes de bande dessinée. La bande dessinée numérique interactive propose pour sa part un récit qui pourrait se situer avant le début de l’histoire mise en scène dans l’album : le renard tente d’entrer dans la ferme pour s’introduire dans le poulailler. Régulièrement, le récit, que le lecteur fait défiler grâce à des flèches, s’interrompt et propose des options pour la suite de l’histoire, seule une combinaison précise de choix permettant au renard d’accéder à son but (Fig. 5).
Fig. 5 : Le premier choix proposé dans la bande dessinée interactive. Capture d’écran du Turbomedia.
35D’un point de vue économique, ces productions permettent de promouvoir l’album. Un concours fut d’ailleurs organisé permettant aux vingt premiers internautes ayant réussi à trouver la solution de la bande dessinée interactive de gagner un album du Grand Méchant Renard dédicacé par l’auteur. Sur le plan narratif, elles proposent une extension de l’univers diégétique et forment, avec l’album, un réseau transmédial au sein duquel les différentes éléments paratextuels renvoient aux autres œuvres : la dernière page de l’album inclut un QR code permettant d’accéder à la bande dessinée interactive, dont un lien est présent sur le site web de l’éditeur et sur le blog de l’auteur, et les dix premières planches de l’album sont mises en ligne sur ce même blog après une courte introduction dessinée où le personnage du cochon18 tient le livre entre ses mains.
36Ces productions confèrent également une dimension ludique au récit. Tandis que l’animation offre le plaisir de voir les personnages « prendre vie », la bande dessinée interactive abolit en partie la distance entre créateur et lecteur en conférant à ce dernier un pouvoir de décision dans le déroulé du récit, rappelant le modèle du blog décrit plus haut. Cette œuvre est diffusée sur le site T, le portail turbomedia (turbointeractive.fr), qui héberge des « turbomedias » et donne la définition suivante de cet objet :
Un turbomedia est une bande dessinée pensée pour le format numérique et pouvant utiliser les possibilités techniques de celui-ci (donc rien à voir avec de la BD numérisée au format PDF, Ebook... que l’on trouve sur internet). Comme le format permet l’utilisation d’animations et d’interactions, il est possible d’utiliser les codes / grammaire de lecture du cinéma, jeux-vidéo et bien évidement de la bande dessinée. Les possibilités de création sont donc infinies, laissant ainsi la place à l’esprit créatif de l’auteur.19
37Bien que le turbomedia du Grand Méchant Renard ne comporte pas d’éléments multimédias (pas d’animation, pas son ni d’images d’autres types comme des photographies ou des vidéos20), il s’inscrit à la croisée de plusieurs médias. Visuellement, la représentation est semblable à ce que l’on trouve dans l’album et dans les autres bandes dessinées de Benjamin Renner : des dessins avec généralement peu de décor, des cases sans cadre délimité et des dialogues sans bulle, simplement reliés aux personnages par un appendice minimal. En revanche, les vignettes ne sont pas mises en série sur la même page, mais se succèdent à l’écran, grâce à une flèche sur laquelle le lecteur doit cliquer, comme pour un diaporama. Régulièrement, le récit propose, à la manière d’un « livre dont vous êtes le héros », différents embranchements parmi lesquels le lecteur peut choisir en cliquant sur l’une des options. Les vignettes sont mises en série selon des modalités rappelant l’animatique (document préparatoire lors de la création d’un film d’animation qui établit une sorte de maquette à partir du storyboard) : les poses-clés du mouvement se succèdent pour esquisser le déroulé spatial et temporel de la scène, mais les poses intermédiaires (intervalles) ne sont pas encore dessinées.
38On pourrait ainsi envisager le réseau de productions du Grand Méchant Renard non seulement comme élaborant une narration transmédiale qui s’appuie largement – mais pas exclusivement – sur les technologies numériques, mais aussi comme un éventail de potentialités graphiques. La question de la mise en série et du rapport entre fixité et mouvement est en particulier au cœur de ces variantes. Dans l’album, on retrouve les niveaux décrits par Raphaël Oesterlé (2016) dans son étude du mouvement dans la bande dessinée : « celui de la case, de la séquence (au sens de suite de cases), voire de la page » (p. 124). Ces niveaux peuvent être par exemple mis en évidence à la page 7 de l’album (Fig. 6). Le mouvement de la case est particulièrement visible dans la cinquième vignette, où les bras du renard sont dessinés dans plusieurs positions pour signifier leur agitation, et un petit nuage de poussière sous le personnage suggère qu’il saute. Le mouvement de la séquence apparaît clairement au sein de chaque strip, notamment dans le second et le troisième, où les vignettes sont de taille semblable et montrent un même point de vue sur une scène dans laquelle les personnages ne changent pas de place. Le mouvement de la page est lui aussi nettement identifiable : les cinq premières vignettes conduisent à l’apogée de l’attaque du renard, et les trois dernières appuient son échec : il est immobile et dominé par les paroles de réprimande de la poule.
Fig. 6 : Page 7 de l’album Le Grand Méchant Renard, de Benjamin Renner. © Éditions Delcourt - 2015
39La séquence animée, quant à elle, analysée image par image, donne à voir une stratégie issue de l’animation limitée : l’utilisation d’un nombre réduit d’images, avec une animation à seulement huit images par seconde, chaque pose étant montrée trois fois d’affilée. De ce choix, qui pourrait être expliqué par une économie de moyens, résulte pourtant un dynamisme singulier. L’animation à huit images par seconde véhicule bien l’apathie et la nonchalance du renard ; en revanche, les trois poussins se déplacent en décalage les uns par rapport aux autres : si chacun est animé à huit images par seconde, il y en a toujours un qui se déplace d’une image à l’autre, créant ainsi un effet sautillant et de rapidité qui contraste avec le rythme lent du renard. Le plan est fixe et il n’y a aucun décor : les personnages évoluent sur un fond blanc, sous le titre du livre écrit en grand. Cette petite scène se situe ainsi dans un espace hybride, qui reconnaît son statut fictionnel tout en jouant avec l’idée que les personnages de l’album en seraient sortis et existeraient réellement (pour preuve, ils bougent !) : le changement de régime de la mise en série graphique alimente le monde diégétique en lui conférent une épaisseur supplémentaire.
40La bande dessinée interactive propose pour sa part une mise en série par remplacement d’images successives, avec l’impression que les poses se succèdent avec une certaine fluidité puisque l’échelle de plan et la position du personnage dans la vignette ne changent pas : en cliquant rapidement sur les flèches, l’usager peut lui-même créer l’illusion d’un mouvement (certes saccadé), d’autant plus qu’à de nombreuses reprises, des cases sans texte se succèdent et figurent une action, invitant à faire défiler la séquence d’images sans s’arrêter longuement sur chacune d’entre elles. Lorsque du texte est présent, au contraire, il s’agit souvent de moments où les personnages ne bougent pas, et le lecteur peut prendre plus de temps sur chaque vignette pour lire le texte ou choisir parmi les options qui lui sont proposées. Le turbomedia offre, de ce fait, une jouabilité à deux niveaux. Sur le plan narratif, on aide le renard à s’introduire dans la ferme par des moyens loufoques (en creusant un tunnel, en grimpant sur un poteau électrique…) et on le suit dans ses mésaventures (le cochon, croyant à une invasion de taupes, dépose de la dynamite dans le tunnel, le renard s’électrocute…). Le récit présente un objectif simple, guide le lecteur dans une structure arborescente, et invite, du fait de sa forme de « livre dont vous êtes le héros », à s’identifier avec le renard tout en se moquant de lui. Sur le plan graphique, le lecteur a le sentiment de pouvoir synthétiser lui-même un mouvement en cliquant sur la flèche pour faire défiler la séquence d’images.
41Album, séquence animée et bande dessinée interactive se présentent ainsi comme des variantes à la fois narratives et graphiques. Les technologies numériques jouent un rôle majeur dans ce réseau transmédial, tant au niveau de la création que de la diffusion, de la circulation et de la réception des œuvres.
*
42L’analyse a montré en quoi l’œuvre de Benjamin Renner tisse un réseau narratif, technique et graphique riche et complexe, que l’étude des œuvres et des modalités de transfert et de relation entre elles a permis de déployer. Le numérique occupe une place importante dans cet ensemble de variantes, mais l’utilisation de ses outils, supports et techniques diffère singulièrement d’un média à l’autre, d’une production à l’autre, et même d’une étape à l’autre dans la création, la diffusion et la réception des œuvres.
43Plus largement, ce cas d’étude ouvre une fenêtre sur la multitude des possibles narratifs et graphiques générés par tel réseau médiatique, en particulier à l’ère du numérique : les variantes permettent de proposer des déclinaisons, des déplacements et des enrichissements de l’univers diégétique et des potentialités du dessin, en s’appuyant sur une combinaison de supports, de formats et d’outils.