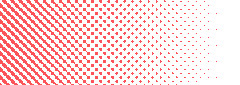De l’intérêt de rééditer les fabliaux
1Le programme du CAPES et de l’Agrégation de lettres 2024 remet à l’honneur des textes, les fabliaux, qui n’avaient pas été proposés aux concours depuis une trentaine d’années1. Or depuis octobre 2022, je dirige un projet de recherche visant à mettre en ligne, sur le site de la Base de Français Médiéval, l’ensemble des fabliaux français du Moyen Âge, dans un double dessein : faciliter l’accès aux textes et, à partir d’un corpus qui s’établit actuellement à cent-quatre-vingt-dix contes à rire, reprendre les critères définitoires du genre « fabliau » élaborés par les critiques avant nous, vérifier leur validité et leur pertinence, et, peut-être, proposer une nouvelle définition qui permettrait de renouveler l’approche du genre. Au début du mois de septembre, nous avons décidé d’établir un corpus « concours » qui s’appuie sur les dix-neuf fabliaux sélectionnés par Jean Dufournet pour son anthologie et propose des éditions refaites d’après les manuscrits qu’il a choisis ainsi que des traductions inédites et commentées. L’établissement de ce corpus m’a fourni l’occasion de confronter mon travail à celui de mon maître, Jean Dufournet, et je souhaite partager avec vous quelques réflexions qui me sont apparues en retravaillant les mêmes textes que lui. Éditer et traduire les fabliaux présente en effet des implications qui ne sont pas seulement philologiques, mais aussi littéraires, car elles engagent la compréhension et l’interprétation des textes. Dans le cadre de cette intervention, je n’ai retenu que quelques points et sélectionné trois fabliaux, Gombert et les deus clers, le Segretain Moine et les Perdrix qui constitueront les trois parties de ma communication.
2La lecture des premiers vers de Gombert et les deus clers donne le sentiment que dame Gillein suscite chez le clerc un amour très similaire à ce que nous décrit la littérature de style élevé – Per Nykrog parle à ce propos, comme on le sait, de « parodie de la littérature courtoise » ou de « burlesque courtois » (Nykrog, 1957, p. 71-74)2 :
De sa fame, dame Gillein,
fu l’un des clers des qu’i la vit
si fous que amer li covint. (v. 6-8 ; ms. C Berlin 2573)
3La rime imparfaite vit/ covint conduit Noomen et Boogaard dans le Nouveau Recueil Complet des Fabliaux (Noomen et Van den Boogaard, 1983-1998, vol. 4 ; p. 296) et Jean Dufournet à corriger le premier verbe en vint, masquant ainsi la réutilisation amusée du cliché de l’amour au premier regard de la littérature courtoise. Ce ne sont pourtant pas les seuls indices de cette réécriture, destinée à faire sourire le public averti car elle transpose, chez les clercs et les rustres, les nobles sentiments des romans de chevalerie. Ces vers sont en effet suivis d’un rapide portrait de la dame reprenant les topoï de la beauté féminine apte à inspirer l’amour4 :
La dame estoit mignote et cointe,
s’ot cler les euz comme cristal. (v. 10-11)
4Et le clerc ne déroge pas à l’attitude traditionnelle de l’amant en ne parvenant pas à détacher ses regards de la dame durant toute la soirée5. Comme on le sait, il réussit finalement à se glisser dans son lit à la faveur du déplacement du berceau et elle se félicite de ses ardeurs sexuelles. Voici comment Jean Dufournet décrit alors son attitude :
« N’avez gueres esté
oiseus ! »
Cil ne fu mie trop
noiseus,
Einz fist totes voies son
bon,
Et cil li let fere le son :
Ne l’en est pas a une
bille !
Li clers qui jut avec sa
fille [...] v. 129-134
« Vous n’avez pas été longtemps inactif. »
Le clerc ne la contraria pas beaucoup, mais il
s’occupa de prendre son
plaisir, la laissant débiter ses propos dont il se
moquait éperdument.
Quant au clerc qui
couchait avec la fille [...]
5Ce comportement du clerc, indifférent à celle qui le captivait peu de temps auparavant, dès lors que son désir est assouvi, s’inscrit dans une tradition misogyne bien attestée dans une partie de la littérature médiévale (Aubert, 1975 ; Bloch, 1993 ; Gargan et B. Lançon, 2013) et confirmée par deux témoins de ce même fabliau, le manuscrit A, Paris BnF français 837, et le manuscrit B, Berne 3546. Jean Dufournet parvient néanmoins à cette traduction au prix de deux menues infractions à la langue médiévale. Il considère que les deux démonstratifs cil des vers 130 et 132 renvoient tous deux au clerc et il substitue au déterminant possessif sa du vers 134 l’article défini la. Or, en ancien français, l’apparition du démonstratif cil marque, dans une très grande majorité des cas, un changement de sujet,
prenant son tour de rôle, nouveau référent à identifier par des informations hors du voisinage immédiat de l’occurrence ; il est alors normalement traduisible par « l’autre ». (Buridant, 2000, §101 p. 133)
6Bien conscient de cette spécificité linguistique, le NRCF se montre embarrassé par ce deuxième cil qui, selon lui, « suggère à tort un changement de sujet » (NRCF, vol. 4, p. 429), et dans son édition du ms. C, il corrige afin de faire disparaître ce cil :
Et cil li let fere le son.
(Berlin 257 v. 132)
Et li laisse fere le son
(NRCF, vol. 4 v. 132 p. 299)
7Sur sa lancée, le NRCF corrige le déterminant possessif du vers 134 :
Li clers qui jut avec sa fille
(Berlin 257 v. 134)
Li clers qui jut avec la fille
(NRCF, v. 134)
8Jean Dufournet, lui, ne corrige pas le manuscrit C, mais il donne l’impression de traduire le manuscrit A, BnF 837.
9Si l’on accepte de revenir à la leçon proposée par le manuscrit de Berlin et de ne pas en corriger les termes, il me semble que le passage se comprend de manière toute différente. Le démonstratif masculin du vers 132 ne peut désigner le clerc, référent proche puisque sujet du vers 130. Il réfère donc à un nouveau référent dont l’identification est fournie par des indices plus lointains, Gombert. Cette identification du second démonstratif cil permet d’expliquer le déterminant possessif sa du vers 134, dont le référent est naturellement le dernier sujet exprimé, le cil du vers 132, Gombert. Alors que pour Jean Dufournet, le clerc laisse la dame faire ce que bon lui semble, le manuscrit de Berlin affirme, selon nous, que c’est Gombert qui laisse le clerc faire ce que bon lui semble – par nécessité : il s’est rendormi dès qu’il s’est recouché. On en arrive à la traduction suivante :
« N’avez gueres esté oiseus ! »
Cil ne fu mie trop noiseus,
einz fist totes voies son bon,
et cil li let fere le son :
ne l’en est pas a une bille !
Li clers qui jut avec sa fille [...]. 129-134
« Vous n’avez guère chômé ! »
Le clerc resta parfaitement silencieux
et continua à prendre son plaisir,
et l’autre, Gombert, le laissa faire :
il ne s’inquiétait de rien !
Le clerc qui couchait avec sa fille [...]
10Nous proposons accessoirement une autre traduction pour l’adjectif noiseus. Le NRCF et Jean Dufournet lui donnent le sens de « querelleur » et traduisent : « l’autre n’éprouvait guère le besoin de contester » ou « le clerc ne la contraria pas beaucoup ». Cette traduction est tout à fait possible, mais peut-être pourrait-on prendre noiseus dans son sens premier de « bruyant »7. Dans ces circonstances où la discrétion est de mise, Jean Bodel userait d’une litote malicieuse « le clerc ne fut guère bruyant » pour « le clerc se tint parfaitement silencieux ». Son attitude manifesterait ainsi davantage sa prudence que son refus du conflit. Elle viserait à prolonger le quiproquo, même si d’autres fabliaux de l’anthologie, comme Haimet et Barat, prouvent qu’une prise de parole du trompeur qui a endossé l’identité d’autrui ne suffit pas à alerter le dupé.
11Dans notre traduction de ce passage, la cible principale du rire n’est plus la dame dont les propos laisseraient le clerc indifférent, mais Gombert, inconscient de ce qui se trame juste à côté de lui et œuvrant sans le savoir à son propre cocuage. On rit du cocu dormant tranquillement pendant que son épouse est enfin satisfaite après des années de frustration conjugale. Il subsiste néanmoins toujours une part de comique misogyne, car la situation de cette femme qui ne s’aperçoit pas que l’homme qui vient de la posséder n’est pas son mari et s’extasie sur ses performances est plaisante8. Cette lecture du passage met en valeur l’art avec lequel Jean Bodel a conçu ses protagonistes. Plutôt que de les confondre dans une sorte de duo indistinct destiné à incarner un type sociologique, comme c’est le cas dans le fabliau apparenté du Meunier et des deux clercs ou dans les autres témoins9, il leur prête des personnalités différentes, même si leur appétit sexuel est identique : l’un est un butor qui part à l’assaut de la fille de Gombert sans aucun ménagement et se vante de ses bonnes fortunes, l’autre paraît plus réservé et moins fanfaron. Cette interprétation nuance l’avis porté par Per Nykrog sur ces deux écoliers dont la façon d’agir, écrit-il,
n’implique aucun respect social pour les femmes auxquelles ils font la cour. (Nykrog, 1957, p. 117).
12Elle confirme au contraire le jugement de Philippe Ménard :
On trouve de tout dans les fabliaux : des héros croqués à gros traits et des personnages plus complexes et plus humains10. (Ménard, 1983, p. 222)
13Dans ce premier exemple, l’établissement du texte par Jean Dufournet respecte la lettre du manuscrit, et seule la traduction est sujette à discussion. Il en va autrement dans un deuxième cas, tiré du plus long fabliau de l’anthologie, le Segretain moine. Guillaume a brisé le crâne du sacristain qui voulait monnayer les faveurs de son épouse au moment où il s’est présenté chez lui pour passer à l’acte. Une première fois, il a tenté de se débarrasser du cadavre en l’installant dans les latrines de l’abbaye pour donner à croire qu’il avait été tué là-bas. Mais le prieur, inquiet d’être accusé du meurtre car il s’est querellé avec lui, dépose le cadavre devant la porte de la plus belle bourgeoise de la ville afin de détourner les soupçons. Guillaume et Idoine retrouvent alors l’encombrant cadavre devant chez eux. Le héros entreprend une seconde fois de le faire disparaître. Passant à côté du tas de fumier de Thibaud, un riche paysan, il a l’idée d’y enfouir le sacristain. Un voleur a cependant dérobé à Thibaud un cochon mis à sécher et, faute de mieux, l’a dissimulé dans le fumier en attendant de pouvoir en disposer. Guillaume commence alors à creuser à pleines mains et :
Le bacon sent, si s’esbahi,
Que li larron ot enfoï.
La coanne vit nerçoier,
Puis le commence a deslïer.
(Jean Dufournet v. 547-550)
Il sentit le cochon que le voleur avait enfoui. Il vit
la couenne qui était
noire, et il commença à
le détacher.
(Jean Dufournet p. 219-221)
14On ne perçoit pas immédiatement à quoi renvoie le pronom personnel le dans la traduction « il commença à le détacher ». De toute évidence, il ne peut s’agir du cochon qui n’est pas attaché au fumier et il faut comprendre que ce le de la traduction renvoie au sac fermé dans lequel le bacon est placé, comme l’explique le NRCF :
Le pronom régime se rapporte évidemment à sac, terme qui ne se retrouve pas dans la leçon [du manuscrit]. (NRCF, vol. 7, p. 370.)
15Le verbe deslier ferait donc référence à l’ouverture du sac dans lequel se trouve le cochon, mais la mention de ce sac aurait disparu au cours de la transmission du texte. On pourrait traduire puis le commence a deslïer par « puis il commence à ouvrir le sac qui le renferme/ qui renferme le cochon ». Cette interprétation laisse subsister cependant un problème majeur à mes yeux : si le verbe deslier indique que le cochon se trouve dans un sac que Guillaume doit ouvrir, comment ce dernier peut-il « voir » sa couenne noire ? Le texte indique clairement la chronologie des deux actions en utilisant l’adverbe puis : Guillaume voit la couenne noire, puis commence à ouvrir le sac.
16Face à cette difficulté, le recours au manuscrit peut être fructueux. Bien que Jean Dufournet affirme, page 367, avoir édité le manuscrit H Paris BnF fr. 2168, qui contient la première version du texte abrégée en 500 vers, il a en fait édité la deuxième version, de 816 octosyllabes, d’après le manuscrit C, Berlin 25711. Il a par ailleurs corrigé la leçon fournie par le manuscrit C et cette correction devait s’imposer à ses yeux puisqu’il ne la signale pas dans ses notes. De fait, dans ce manuscrit, pas de trace du substantif coanne. C’est le terme gone, le manteau, l’habit porté par les moines, qui apparaît :
La gone vit il nerçoier
puis le conmence a deslïer.
17Pour le NRCF, le copiste de C a commis une erreur :
C a mal compris son modèle : dans C543 il remplace coanne par gone 'robe, soutane' et intercale il pour sauver le mètre. (NRCF, vol. 7, p. 370)
18Le terme gone serait une coquille, une bévue, provenant d’une mauvaise compréhension du modèle que le scribe recopiait. Que dit littéralement le manuscrit de Berlin ?
Il vit apparaître, noir12, un habit de moine,
puis commença à en défaire les liens13.
19Il ne s’agit évidemment pas d’un véritable moine noir, c’est-à-dire d’un bénédictin recouvert de son manteau, mais d’un cochon enfermé dans un sac de toile. Mais l’auteur nous permet de voir la scène à travers le regard de Guillaume, en focalisation interne, et d’accéder à la manière dont il l’interprète. Le héros, qui allait enfouir le segretain dans ce tas de fumier, est prédisposé à y découvrir un autre moine. Toutes les conditions sont réunies pour qu’il soit enclin à croire que d’autres ont pu avoir la même idée que lui. Selon nous, il faut maintenir la leçon du manuscrit et considérer que gone résulte d’une focalisation interne nous donnant à lire ce que Guillaume s’imagine voir, l’habit d’un autre moine. Les vers qui suivent immédiatement le passage confirment d’ailleurs cette interprétation puisque Guillaume déclare :
[…] « Tot por voir,
ci a .i. autre moigne noir
qui mout nercie, ce me semble ! »
(v. 551-553 de l’édition de Dufournet)
20Nous proposons donc d’éditer et de traduire ainsi :
La gone vit il nerçoier
puis le conmence a deslïer.
Ce dit Guillaume : « Tot por voir,
ci a .i. autre moigne noir
qui mout nercie, ce me semble ! »
Il crut voir apparaître un manteau de moine noir
et commença à en défaire les liens.
« En vérité, dit Guillaume,
il y a ici un autre moine noir
dont l’habit noircit beaucoup, me semble-t-il ! »
21Établir le texte ainsi n’en change pas l’interprétation d’ensemble, mais révèle la dextérité avec laquelle sont utilisés les procédés narratifs pour créer le comique et les effets de surprise. Le narrateur feint de ne pas en savoir plus que le personnage et nous fait partager, de l’intérieur, son interprétation erronée des événements. Le rire naît de l’écart entre ce que sait l’auditoire – un cochon est dissimulé dans le fumier – et ce que pense Guillaume dans sa précipitation et son affolement – le fumier est déjà occupé par un premier moine assassiné. Si nous avons raison, cette leçon tendrait à prouver la supériorité du manuscrit C sur le manuscrit D (Paris, BnF fr. 19152) que le NRCF a préféré éditer en le jugeant supérieur14.
22Ce deuxième exemple emprunté au Segretain moine met en lumière les choix auxquels tout éditeur de texte est confronté : face à une leçon apparemment aberrante et / ou isolée, faut-il corriger ou ne pas corriger le manuscrit ? En bonne bédiériste, j’aurais tendance à ne corriger qu’en tout dernier recours, quand l’erreur me paraît indubitable15. Mais l’éditeur a d’autres tâches, apparemment plus simples : il lui incombe de ponctuer le récit. Or la ponctuation est parfois moins anodine qu’on ne pourrait le croire comme le montrera un troisième et dernier exemple tiré du début du fabliau des Perdrix. Un paysan est parvenu à s’emparer de deux perdrix, mets délicats habituellement réservés aux tables aristocratiques, grâce à un piège disposé dans son jardin. Il les plume et les confie à son épouse afin qu’elle les mette à cuire à la broche, puis il s’absente pour inviter le prêtre du village à partager leur repas. Cependant il s’attarde, les perdrix sont cuites, et le mari n’est toujours pas de retour. Alors :
La dame a la haste jus mis,
S’en pinça une peleüre,
Quar molt ama la lecheüre.
Quant Dieus li dona a avoir,
Ne beoit pas a grant avoir,
Mes a toz ses bons a16 acomplir. (sic)
(v. 14-19 (J. Dufournet))
23Et Jean Dufournet traduit :
La dame déposa la broche et préleva un peu de peau, car elle raffolait des bonnes choses. Quand Dieu se montrait favorable, elle souhaitait non pas être très riche, mais plutôt satisfaire tous ses désirs. [p. 143 §14]
24Tous les éditeurs ou traducteurs du texte mettent un point final après lecheüre. Tous comprennent que ce terme est pris dans un sens général : « elle raffolait des bonnes choses » (Jean Dufournet), « la gourmandise était son faible » (Rouget, 1978, p. 36), « elle était gourmande » (Jean-Claude Aubailly, 1987, p. 82). Tous estiment que l’expression grant avoir au vers 18 renvoie aux richesses, aux biens matériels.
Quand il lui arrivait de disposer de quelques moyens, elle n’aspirait pas à accumuler de grandes richesses, mais à satisfaire tous ses désirs. (NRCF, vol. 4 no21, p. 365)
Lorsque Dieu la favorisait, elle rêvait, non d’être riche, mais de contenter ses désirs. (Gilbert Rouget)
Quand Dieu lui offrait quelque chose, elle ne souhaitait jamais la richesse, mais seulement la satisfaction de ses désirs (J.-C. Aubailly)
25Ils interprètent donc tous ces vers comme une description générale de la dame et de son attitude dans la vie qui ferait d’elle l’incarnation d’un type de vice féminin bien précis, la gula, la gourmandise et, plus largement, le plaisir des sens gustatifs, que ces six vers opposeraient à l’avaritia, l’avarice, la cupidité.
26Le nombre et la concordance de ces traductions devraient sans doute réduire au silence toute voix discordante. Cependant, deux points nous gênent. Il ne sera plus jamais question du fait d’être riche ou de ne pas l’être dans la suite du texte, alors que les récits brefs ne s’embarrassent guère de détails inutiles17. Serait-on en présence d’un vers de remplissage destiné à trouver une rime à avoir ? De surcroît, je ne suis pas convaincue que ces vers interrompent le récit pour tracer brièvement un portait global, général, de la dame. Ne pourraient-ils référer à la situation précise dans laquelle elle se trouve ? Que fait-on quand on vient d’ôter de la broche des perdrix dorées, croustillantes, odorantes et qu’on est gourmande ? On se lèche les doigts, comme le fera précisément la dame au vers 46 :
Ses dois en leche tout entor.
27Or le premier sens signalé par le Godefroy et le FEW est bien celui-là. La lecheüre est « l’action de lécher », puis seulement par extension, au figuré, « l’amour du plaisir, de la volupté ». Le Tobler-Lommatzsch comprend d’ailleurs comme nous puisqu’à l’entrée lecheüre, il cite les vers du fabliau des Perdrix et fournit le sens de naschen, c’est-à-dire « goûter, grignoter »18. Ce sens nous paraît imposer une modification de la ponctuation qui vient rompre le couplet d’octosyllabes aux vers 17-18 :
La dame a le haste jus mis,
s’en pinça une peleüre
quar molt ama la lecheüre
quant Diex li dona a avoir.
Ne beoit pas a grant avoir,
mes a toz ses bons acomplir. v. 14-19
28Nous proposons de traduire :
La dame déposa la broche
et préleva un morceau de peau
car elle appréciait beaucoup cette gourmandise/ d’y goûter
quand Dieu lui permettait d’en bénéficier/ en donnait l’occasion.
Elle ne désirait pas en prendre beaucoup,
mais assouvir toute son envie.
29Dans cette interprétation, le terme lecheüre n’est pas pris dans un sens élargi d’« amour du plaisir, bombance », mais dans son sens premier d’« action de lécher, grignotage », et concerne précisément le fait de grignoter la peau de la perdrix. Grant n’est plus un adjectif qualificatif d’avoir utilisé comme substantif au sens de « richesse, biens matériels », mais un adverbe signifiant « beaucoup [de quelque chose] »19. La rime des vers 17-18 rapprocherait le verbe avoir pris dans deux sens différents : « disposer, bénéficier de quelque chose » au vers 17 (DMF I-B) et « prendre, acquérir, obtenir quelque chose » au vers 18 (DMF I-A). Sur le fond, le fabliau laisserait entrevoir les pensées animant la gourmande au moment où elle détache un morceau de peau. Il nous fournirait l’excuse qu’elle se donne : « je ne désire pas en avoir beaucoup ! ». L’auteur nous permettrait plaisamment de saisir la dame à l’instant où elle se ment à elle-même et le rire proviendrait du contraste avec les faits ultérieurs, la dévoration solitaire des deux perdrix. Il ne serait plus question d’aborder le personnage sous le plan du type mais, avec un matérialisme qui ne déplairait pas à Alain Corbellari (2015), de décrire sa réaction dans une situation donnée. Par ailleurs, rattacher le vers 17 « quand Dieu lui en donnait l’occasion » au fait de grignoter la peau bien rôtie de la perdrix réhabilite la gourmandise féminine car les plaisirs de la table sont alors présentés comme offerts par Dieu, par opposition à la fois à l’éthique religieuse du temps, qui plaçait la gourmandise parmi les péchés capitaux, et aux imprécations des clercs contre la gloutonnerie des femmes20. Cette réhabilitation du corps et de ses besoins n’est pas sans rappeler la morale prônée dans la deuxième partie du xiiie siècle par le Roman de la rose de Jean de Meun. Ces vers, ainsi édités et traduits, se montrent en fait plus cohérents avec le reste du fabliau où, selon la formule de Dominique Boutet,
les défauts attribués [à la] femme sont exploités dans un sens exclusivement comique, et servent de point de départ à une intrigue riche en rebondissements [sans que] le topos [ait] la moindre fonction idéologique. (Boutet, 1985, p. 4).
30La dame fait montre d’une gourmandise qui finit par se substituer au plaisir de la chair, comme l’a analysé Claudia Müller (Müller, 2000, p. 135-147. Voir aussi Kohler, 2004, p. 137-150 ; et Labère, 2021), mais plutôt que de stigmatiser la gloutonnerie féminine, l’auteur choisit d’en rire.
31Ces quelques exemples mettent en lumière l’intérêt scientifique majeur qu’il y a à rééditer les fabliaux, tels qu’ils sont transmis par les manuscrits, selon une démarche bédiériste limitant strictement les interventions de l’éditeur. Essayer de reconstituer un hypothétique texte originel en piochant de-ci, de-là, dans les différents témoins, accroît la part de subjectivité car on privilégie souvent les leçons les plus évidentes au détriment des lectiones difficiliores, pourtant plus intéressantes au niveau du sens et de la forme. Il nous semble incontestablement préférable d’utiliser les ressources numériques pour donner l’accès à tous les témoins d’un même fabliau, comme nous le ferons, à terme, sur la Base de Français Médiéval. Ces trois cas prouvent par ailleurs qu’il est toujours nécessaire de proposer une traduction, non seulement pour qu’un grand nombre de lecteurs puissent accéder à des textes médiévaux qu’ils connaissent mal, mais aussi pour mettre en lumière les passages ambigus, souvent plus stimulants intellectuellement. De fait, les contes à rire, qui laissent une large place au vocabulaire et aux structures syntaxiques du langage populaire, se montrent souvent plus complexes à éditer et à traduire que la littérature de style élevé, mais aussi peut-être, plus riches à commenter.