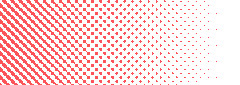Critiquer l’art au féminin entre 1870 et 1890, les stratégies d’accès à l’écriture
1Les salonnières actives au cours du XIXe siècle se sont peu imposées dans l’histoire de la critique d’art. Des plus connues d’entre elles, Gustave Haller, Claude Vignon ou encore Marc de Montifaud, les noms derrière lesquels se cachent respectivement Valérie Simonin (1831-1919), Marie-Noémi Cadiot (1832-1888) et Marie-Amélie Chartroule de Montifaud (1845-1912), nous n’avons retenu que les pseudonymes masculins. Le maigre usage des termes « salonnière » ou « critique d’art femme » dans les périodiques traduit à lui seul les difficultés rencontrées par les femmes désireuses de s’illustrer dans cette pratique. La critique d’art se manifeste pourtant sous la plume des femmes1 comme de celle des hommes. Celles-ci ont intégré, bien qu’à des degrés différents, les trois pôles de création2 de la critique d’art définis par ses historiens : le pôle scientifique, des historiens et historiennes de l’art, le pôle littéraire, des hommes et femmes de lettres et le pôle journalistique, des spécialistes de la presse. La physiologie de la scène artistique française de la seconde moitié du XIXe siècle nous encourage à associer l’étude des critiques d’art femmes à celle des artistes du même sexe. Au cours des deux décennies qui concernent notre observation, les initiatives menées par les actrices du monde de l’art témoignent de leur volonté de s’y organiser de manière plus autonome afin de gagner en reconnaissance professionnelle. L’année 1881, marquée par la loi sur la liberté de la presse, est aussi celle de la création de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS), fondée par la sculptrice Hélène Bertaux (1825-1909). Les revendications majeures de ce groupe, orientées vers la reconnaissance de l’artiste femme et l’accès, au même titre que les hommes, à l’École des beaux-arts et au concours du Prix de Rome3, sont renforcées par la création du salon de l’UFPS qui octroie une nouvelle visibilité aux peintres et sculptrices à partir de 1882. Alors qu’elles sont tenues de ruser pour s’imposer comme artistes à part entière, comment les femmes accèdent-elle à l’écriture d’un discours sur l’art contemporain s’il n’est même pas attendu d’elles qu’elles en soit les créatrices ? Les parcours de quelques critiques actives entre 1870 et 1890 nous permettent de dessiner un panorama des stratégies leur permettant non seulement d’accéder aux organes de publication mais aussi d’y assurer leur position de salonnière. Les participations ponctuelles de certaines femmes de lettres désireuses de s’exercer à la critique d’art sont aussi l’occasion d’aborder le détournement des codes – littéraires comme genrés – au profit de l’écriture d’un discours critique.
Devenir et demeurer salonnière, entre réseaux masculins et sororité
2Marc de Montifaud, pseudonyme masculin emprunté par Marie-Amélie Chartroule de Montifaud4, est l’une des rares salonnières actives dans une revue artistique prestigieuse autour de 1870. Nous savons que son mariage célébré en 1864 avec Léon Quivogne de Luna (1829-1901), secrétaire d’Arsène Houssaye (1814-1896), directeur de L’Artiste, lui permet d’y publier ses premiers comptes rendus d’exposition dès 1865. La recherche a déjà mis en évidence le bénéfice d’une parentalité masculine pour percer au sein d’un cercle professionnel. Néanmoins, réduire ces critiques au succès professionnel de leur époux ou de leur père reviendrait à occulter la majeure partie de leur carrière et leur force d’action. Nourrissant elle aussi son réseau d’opportunités, Marc de Montifaud est rédactrice en chef, en 1867, de La Haute vie : gazette parisienne, qui publie entre autres des textes d’Arsène Houssaye, Charles Coligny (1834-1874) ou encore Alfred des Essarts (1811-1893) et, en 1875, de L’Art moderne, où sont relevés les noms de Jules Claretie (1840-1913), Armand Silvestre (1837-1901) ou encore Olympe Audouard (1832-1890).
3Si le réseau est souvent indispensable pour intégrer une revue, il ne suffit pas pour assurer sa position de critique d’art. La légitimité de Marie-Amélie Chartroule de Montifaud à écrire dans une revue scientifique, renforcée par sa formation auprès du peintre Jean-Baptiste Ange Tissier (1814-1876), est assurée par la qualité scientifique de son discours et ses prises de positions. Bien que ses revendications en faveur de l’émancipation féminine soient connues, les Salons de Marc de Montifaud ne commentent que peu d’œuvres exposées par des femmes. Partisane de la peinture du nu, c’est majoritairement vers sa défense et ses grands représentants qu’elle oriente son discours. Quelques femmes, dont la reconnaissance n’est souvent plus à construire, sont tout de même parfois citées par la critique. À cet égard, elle mentionne Rosa Bonheur en 1865 (Montifaud, 1865, p. 269), élevée au rang de chevalier de la Légion d’honneur la même année, Hélène Bertaux en 1866 (Montifaud, 1866, p. 205), future fondatrice de l’UFPS ou encore Delphine de Cool en 1873 (Montifaud, 1873, p. 368), directrice d’une école de dessin pour jeunes filles. Laissant transparaître son intérêt pour le sujet sans se risquer à un soutien excessif et injustifié, elle écrit qu’au Salon de 1868, « les femmes artistes sont nombreuses, il faut les distinguer » (Montifaud, 1868, p. 63). Parfois sévère, comme à l’occasion du commentaire sur le Portrait du président Thiers de Nélie Jacquemart (1841-1912) en 18725, la qualité scientifique des comptes rendus comme l’impartialité priment chez Marc de Montifaud. En 1875, elle écrit, à propos de l’envoi d’Alix Duval (1848- 1875) :
[…] la Jeune Mère, c’est le tableau de genre par excellence, avec son sujet sympathique, et sa pointe de sentiment. À quoi bon décrire ce que toutes les femmes ont déjà deviné ? Il y a un petit enfant, puisqu’il y a une jeune mère ! […] Ajoutons beaucoup d’élégance, et un goût tout féminin dans l’arrangement et le choix des ajustements (Montifaud, 1875, p. 11)
4Commentant une scène de maternité, Marc de Montifaud réconcilie l’artiste femme avec le concept de féminité et ses codes, justifiant non seulement la pratique d’Alix Duval mais proposant un discours susceptible d’être apprécié par le lectorat de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors que l’on connait les difficultés rencontrées par les critiques d’art femmes à cette période, s’attarder sur les productions d’artistes du même sexe également en peine de reconnaissance professionnelle, peut s’avérer périlleux. Il n’en reste pas moins qu’en les soutenant ponctuellement à l’aide de discours argumentés dans un ensemble de comptes rendus scientifiques, Marc de Montifaud offre aux peintres et sculptrices une visibilité dans une revue prestigieuse, sans risquer elle-même la disqualification de son discours et compromettre sa place de salonnière.
5Animées par une plus grande autonomie professionnelle, les femmes de lettres se libèrent progressivement de la parentèle masculine comme unique moyen d’accès aux professions enviées. Créant par elles-mêmes de nouveaux organes de presse, elles fournissent aux intellectuelles du monde littéraire et artistique des espaces de publication au sein desquels il leur est plus facile de publier.
6Émilie Paton (1820-1887), sous le pseudonyme de Jacques Rozier est l’une de celles qui bénéficient d’espaces de publications dirigés en partie par des femmes pour y publier ses comptes rendus critiques de 1868 à 1879. Née Émilie Pacini, elle détourne le nom de sa mère, Jacqueline Rozier, pour signer ses articles. Sa fille, Jacqueline Commere-Paton (1859-1955), issue de son mariage avec le journaliste Jules Paton en 1846, deviendra peintre.
7C’est au sein des revues dirigées par Jeanne d’Astorga (?-?), Les petites affiches de la mode et La fantaisie parisienne, que Jacques Rozier publie la majorité de ses comptes rendus d’exposition. Présentée à plusieurs reprises comme un « collaborateur » (Parmentier, 1872, p. 10) précieux, son sexe est systématiquement dissimulé par le périodique. En confirmant la masculinité de son critique d’art, la revue s’assure que son lectorat prendra au sérieux les Salons qu’elle publie.
8Forte de sa position, elle en profite pour soutenir à plusieurs reprises des artistes qui lui sont proches. En 1870, elle attribue le plus grand succès du Salon à Cabanel, qui réalise un portrait d’elle au fusain en 1852 et forme sa fille à la peinture. Son beau-fils, Léon Commere, fait aussi l’objet d’un soutien affirmé en 1872 : « M. Commere, élève de M. Cabanel, a exposé sous le n° 10 une toile qui est certainement une des plus remarquées de cette Exposition : c’est, selon moi, le troisième concurrent au prix de Rome et peut-être celui auquel je crois le plus de chance » (Rozier, 1872, p. 11). Les artistes femmes bénéficient également de son intérêt. En 1872, elle encourage leur pratique du portrait :
J’ai voulu réserver une place à part aux femmes qui se consacrent à la spécialité du portrait ; elles sont très nombreuses, car, après en avoir cité une vingtaine, celles qui ont attiré surtout notre attention de critique, j’en aurai laissé un grand nombre qui mériteront une autre année, n’en doutons pas, de figurer parmi leurs devancières. La nature de la femme la rend, selon moi, plus apte que bien des hommes à ce genre de travail ; elle s’oublie plus volontiers, elle a plus de délicatesse d’observation de son semblable, qu’elle étudie par habitude pour le critique peut-être. Si une artiste intelligente faisait de sérieuses études de peinture et arrivait à exécuter plus énergiquement ce que sa finesse féminine lui révèle dans son modèle, nous verrions renaître les succès bien mérités des Vigée-Lebrun et Kaufmann. (Rozier, 1872, p. 12.)
9Sans leur concéder un soutien injustifié mais s’appliquant à légitimer leur pratique en citant les noms des artistes femmes que l’histoire de l’art a retenues, elle revendique leur spécificité féminine comme atout. Poursuivant sa pratique de salonnière dans L’École des femmes fondée en 1879 par Mme M.-F. de Saverny, pseudonyme de Marie d’Ajac (?-?), elle défend de nouveaux les artistes femmes et particulièrement sa propre fille, qui deviendra membre de l’UFPS à partir de 1896 (Sanchez, 2010, p. 388) :
Mlle Jacqueline Paton. Après le maître, citons son intéressante élève, qu’il a élevée, et dont il forme le talent. Ici, la nature fait tous les frais, et à 20 ans cette artiste, déjà connue, expose deux bons portraits : Mgr Mermillod, évêque de Genève (art pur, dessin correct, seulement réservé) et Miss W…, une jeune Américaine, d’une physionomie attractive. Ces deux toiles ont été très remarquées, et placent leur auteur au rang des talents sur lesquels on compte dans l’avenir. (Rozier, 1879, p. 57.)
10Non seulement Jacques Rozier a bénéficié des initiatives féminines pour publier ses comptes rendus dans des journaux féminins, mais cette pratique critique lui a servi de tremplin à une reconnaissance professionnelle et officielle. Membre de la Société des gens de lettres à partir de 1878 (Anonyme, 1878, p. 1), elle publie dès l’année suivante un article au sujet de Léon Commere dans L’Artiste (Rozier, 1882) et est élevée au rang d’officière d’académie en 1886. Forte de sa position de critique au sein d’un réseau professionnel féminin, elle a aussi œuvré, en stratégie de promotion mais aussi d’autopromotion, à la reconnaissance des femmes dans le monde de l’art.
11Il n’en reste pas moins que la sororité et cette double stratégie de promotion se manifestent plus vivement encore au sein des organes de presse féministes. Le parcours de Marie Bashkirtseff (1858-1884) est notamment connu grâce à son journal intime relatant sa formation à l’académie Julian et témoignant de son ambition professionnelle. Alors qu’elle est décédée à l’âge de 26 ans, un prix est fondé en son honneur pour récompenser les jeunes artistes du Salon. Exposée par l’UFPS dès 1884 (Sanchez, 2010, p. 139), elle est un modèle pour les artistes contemporaines. En parallèle de sa pratique artistique qui lui en assurait toutes les compétences, elle rédige pour le journal féministe d’Hubertine Auclert (1848-1914) fondé en 1881, La Citoyenne, quelques articles et comptes rendus d’exposition signés Pauline Orell. Bénéficiant d’un réseau militant pour défendre à travers ses écrits les artistes femmes, elle use aussi de sa position comme stratégie de promotion et d’autopromotion. Sans oublier de donner une visibilité à quelques artistes femmes dans ses comptes rendus assez sévères, elle revendique vivement leur accès à l’École des beaux-arts (Orell, 1881). Les comptes rendus de Léonie Mulier (?-?) méritent aussi d’être mentionnés6. Salonnière pour La Femme dans la famille et dans la société, dirigée par la femme de lettres et féministe Louise Koppe (1846-1900), ses comptes rendus de 1884 sont bien plus radicaux : du Salon, elle ne mentionne que les envois d’artistes femmes, laissant de côté les hommes. Témoignant de son militantisme, elle conclut ainsi son article :
Mais je veux insister surtout sur la déconvenue particulière que j’ai éprouvée en ne trouvant pas parmi les exposantes Mme Berteaux [sic], l’éminent sculpteur, un chef d’école […]. Nous pensons que l’abstention de Mme Berteaux [sic] est seulement occasionnée par les préoccupations que lui donne la présidence de l’Union des femmes peintres et sculpteurs, dont la dernière exposition fut si remarquable et si complète (Mulier, 1884, p. 101).
12Profitant d’espaces de publications féminins et féministes pour publier ses comptes rendus militants, elle offre à son tour une place d’honneur aux peintres et sculptrices et encourage leurs initiatives.
13Les salonnières évoquées, bénéficiant souvent d’un proche issu du milieu littéraire et artistique pour accéder à la publication de textes critiques, tentent de se détacher de ce patronage masculin. Constituant de nouveaux réseaux féminins au sein desquels gravitent intellectuelles, artistes et femmes de lettres, elles créent des espaces de publications propices à accueillir en leur sein des critiques d’art du même sexe. Les deux décennies qui concernent notre étude sont ponctuées par la création d’organes de presse dirigés par des femmes comme par la formation d’unions d’artistes femmes. Moins contraintes que dans des revues artistiques souvent dirigées par des hommes, elles y défendent, par stratégie de promotion comme d’autopromotion, les actrices du monde de l’art. Ne dissimulant plus leur sexe derrière des pseudonymes masculins, elles légitiment dans des revues militantes leur propre pratique en se faisant une spécificité d’un « art féminin ». En effet, qui de mieux qu’une femme pour écrire sur les productions féminines ? Revendiquer la spécificité d’une critique d’art au féminin est aussi l’une des stratégies mises en place par des femmes de lettres qui, n’ayant pas accès à la position de salonnière, participent ponctuellement à l’écriture du discours sur l’art contemporain grâce au détournement des genres littéraires et des rubriques journalistiques.
Détourner les genres
14Si la position de critique d’art n’est pas accessible à toutes, l’écriture d’un discours sur l’art contemporain n’est pas réservée à ceux et celles en charge de la rubrique du Salon. Si la définition de la critique d’art la restreint au compte rendu d’exposition, les femmes profitent de manière régulière de rubriques journalistiques parfois spécifiquement féminines pour proposer un discours sur les productions artistiques contemporaines.
15Alors que Marc de Montifaud était en charge, pour la première fois, du Salon dans L’Artiste, une autre femme y publie quelques lignes à propos de l’exposition annuelle de 1865. Dans une chronique mondaine intitulée « Gazette du monde parisien », La Dame de Trèfle exploite cette rubrique féminine pour pratiquer la critique d’art en quelques-uns de ses passages :
Voici Meissonier fils qui, selon M. Marc de Montifaux [sic], vient de nous livrer son premier tableau, sa première composition : Un savant dans son cabinet. S’il en est réellement le seul auteur et si la main supérieure n’a rien donné à cette toile, elle annonce de l’avenir et elle nous promet un digne successeur de celui dont on parie les productions au poids de l’or. Seulement, s’il nous était permis de faire ici une observation, nous dirions que la perfection des détails nuit à la perspective, et que pour avoir voulu exprimer les fonds avec trop d’exactitude, M. Meissonier a manqué l’un des effets nécessaires au genre qu’il a adopté ; c’est cette même perspective dont nous parlions, si admirable dans les tableaux flamands et hollandais, surtout ceux de Rembrandt où la lumière et le clair-obscur jouent le rôle principal. À part ce défaut, la figure du savant indique bien le travail de l’intelligence en proie à quelque problème ; les livres épars, les pages commencées, le demi-jour qui donne une physionomie à cette pièce sombre, tout cela est bien compris et rendu avec une science de dessin exquise (La Dame de Trèfle, 1865, p. 87).
16Derrière ce pseudonyme se cache Marie-Amélie Gelot de Saint-Amey (Joliet, 1884, p. 20) (1844-1901)7, qui épouse l’homme de lettres Albert Delpit en 1873, puis, après leur divorce8, l’artiste peintre Dominique-Félix de Vuillefroy de Silly en 18879. Chargée de la chronique mondaine de L’Artiste, rubrique fréquemment tenue par une femme, elle se détourne un instant des anecdotes et des nouvelles modes pour donner un commentaire, court mais raisonné, de l’envoi de Meissonier fils. Mêlant la description de la peinture à une analyse ancrée dans l’histoire de l’art, citant les maîtres flamands et hollandais dont Rembrandt, elle légitime son discours en lui donnant une valeur scientifique. Notons à cet égard que les femmes deviennent plus facilement historiennes de l’art que critiques d’art à cette période. Au tournant du siècle, elles figurent en nombre bien plus important dans les registres de l’École du Louvre que dans les signatures des critiques d’art. Introduisant son article par un argumentaire visant à légitimer tant sa pratique journalistique dans une revue artistique que celles des femmes peintres et sculptrices, elle écrit :
Hélas ! vous vous étonnez, ma belle amie, de me voir écrire, moi qui jusqu’ici n’écrivais même pas mes comptes de cuisinière. Songez que j’écris dans un journal d’art et que c’est une femme qui a inventé la peinture. […] une jeune fille Dibutade en fut l’inventrice, en dessinant sur le sable son amant, qu’elle avait trouvé endormi, le paresseux ! (La Dame de Trèfle, 1865, p. 87)
17Remémorant non seulement le rôle des femmes dans l’histoire de la peinture, elle insiste encore sur leur réussite en citant, entre autres, les parcours de Marguerite Van Eyck et d’Élisabeth Chéron. Marie-Amélie de Saint-Amey n’est pas la seule à détourner des rubriques féminines au profit d’un discours critique. Chargée de rédiger la chronique mondaine de La Revue diplomatique, Marie Berthe Ollivier-Honnorat (1847-1918), sous le pseudonyme féminin de Berthe de Présilly10, profite de la rédaction d’un article intitulé « Le courrier du high-life » pour donner quelques mots du vernissage du salon de l’UFPS de 1889. Orientant pourtant le début de son article sur les toilettes féminines, celles-ci sont un prétexte pour rendre compte, rapidement, de l’exposition :
Malgré le mauvais temps, beaucoup de monde jeudi au vernissage du Salon de l’Exposition des femmes peintres et sculpteurs. D’élégantes toilettes, et de genres si variés […] C’est ce que j’ai en effet rencontré le 14 au Palais de l’Industrie, où, parmi les artistes exposants on a beaucoup remarqué les aquarelles de Mlle Marie Adrien, une élève de Rivoire ; ce sont : un bouquet de violettes et dentelle, un panier de lilas, un panier de roses et mûres, et des chrysanthèmes. Coloris et dessin, grâce dans la forme, voilà les qualités particulières à cette jeune artiste qui est certainement appelée à prendre sa place parmi les aquarellistes de talent. Beaucoup s’étonnaient de l’absence de Rosa Venneman, le peintre animalier bien connu. Elle eût pourtant fait honneur au Salon dont Mme Léon Bertaux est la présidente ; et ce n’est cependant pas faute de tableaux à présenter. Peu d’ateliers en sont plus fournis, et peu d’artistes produisent davantage et avec une plus grande facilité. (Présilly de, 1889, p. 9)
18Ce court commentaire, d’ordre journalistique, correspond bien plus à celui d’une chronique mondaine qu’à une critique scientifique. Ne décrivant que peu les détails des œuvres exposées, enchaînant les noms d’artistes, elle insiste surtout sur les éléments et qualités qui associent les productions des peintres et sculptrices au concept de féminité et à l’art dit féminin. Parmi toutes les exposantes, ce sont les aquarelles de la peintre de fleurs Marie Adrien qu’elle remarque. Comme Marie-Amélie Gelot de Saint-Amey, c’est d’un pseudonyme féminin qu’elle signe son article. La féminité de l’auteure étant tout à fait convenable pour la rédaction d’une chronique mondaine, elle peut la revendiquer et, se faisant une spécificité des productions d’artistes du même sexe, légitimer sa propre pratique.
19C’est un récit sentimental que la romancière Marie de Grandfort détourne en 1876 au profit d’un discours critique. S’appropriant de nouveau un genre littéraire convenable aux femmes et dans laquelle l’auteure s’est fait connaître, celle-ci met en scène dans La Fantaisie parisienne, revue ont elle a rejoint la direction, un couple fictif en pleine visite de l’exposition annuelle de peinture et de sculpture. Sur un ton léger et comique, l’épouse, munie d’une liste des tableaux les plus appréciés qui lui ont été recommandés, promène son mari de peinture en peinture. Un rapide coup d’œil au catalogue du Salon de 1876 confirme que les tableaux évoqués dans cette fiction y sont bien exposés. Sans avoir prétention à donner un commentaire précis et scientifique des peintures admirées, Marie de Grandfort nous livre, à travers ses deux protagonistes, une forme de discours critique. Alors que l’épouse prend le rôle d’une néophyte émerveillée rapidement et sensible aux éléments picturaux, l’époux prend celui de l’amateur plus critique. À cet égard, leur discussion au sujet de l’envoi de Firmin Girard exposé sous le numéro 903, donne vie à une scénette amusante :
Elle. – Ah ! voilà donc ce Quai des Fleurs !... C’est charmant, n’est-ce-pas, mon ami ?... Voyez cette femme en batiste écrue… celle qui se penche pour acheter… Et cette marchande… Et le commissionnaire. Oh ! mon ami, le commissionnaire ! Comment pourriez-vous rester froid devant cela !
Lui – Comment je puis rester froid devant le commissionnaire… mais je vous assure que cela m’est bien facile… (Granfort de, 1876, p. 1)
20Si le rire est plaisant, ce sont tout de même ses positions esthétiques que Marie de Grandfort cherche à transmettre. Le portrait d’Émile Girardin, exposé sous le numéro 740, est prétexte à traiter de la composition des portraits contemporains :
Lui. – Le portrait de Girardin est frappant… un peu trop rouge, peut-être… mais c’est admirablement fait…
Elle. – On dirait qu’il va dire une de ces phrases courtes dont il a le secret… Je m’attends à chaque instant à voir sa lèvre se relever dans le coin… Vous savez quand il sourit… Tenez, comme ça… Voyez… […]
Lui, souriant. – Vous ne lui ressemblez pas du tout, ma chérie ; mais vous voyez que pour faire un très beau portrait, on n’a pas besoin de tout ce luxe d’accessoires et d’arrangements à la mode depuis quelques années : - une table couverte d’un drap sombre, un encrier vulgaire, une feuille de papier blanc, une plume et un homme assis de travers sur un fauteuil en velours d’Utrecht suffisent…(Ibid.)
21Enfin, les commentaires sur les portraits de Sarah Bernhardt par Clairin et Louise Abbema, exposés respectivement sous les numéros 433 et 1, traduisent sous les traits de l’humour tantôt sa sensibilité artistique, tantôt ses jugements critiques :
Lui. – […] Tenez, voilà le portrait de Sarah Bernhardt, peint par Clairin.
Elle, rêveuse. – Elle est fantastiquement belle…
Lui. – Elle est plus jolie que ça… Comme tableau, c’est très-bien peint, très-beau d’arrangement, très-riche de coloris… Mais pourquoi avoir donné à la charmante figure du modèle cette expression si étrange ?... Savez-vous ce qu’il faudrait pour faire de ce tableau une œuvre merveilleuse ?... Cette femme ainsi couchée avec sa tête soulevée et aplatie sur le sommet… ses yeux clairs et fixés, sa pâleur crayeuse, ses lèvres entr-ouvertes, ce corps dont on ne soupçonne pas l’existence, perdu dans les enroulements de sa jupe de satin, vrai, cela me représente la femme serpent… la femme chimère… Si au lieu de ces deux adorables petits pieds que nous voyons sortir de sa robe, on voyait la queue chatoyante et souple d’une belle couleuvre, je vous assure que cela serait fort beau et l’allégorie…
Elle. – Vous êtes fou… […] Mais vous êtes à parler, tandis que nous avons encore tant de choses à voir… D’abord, l’autre portrait de Sarah… Celui de Mlle Abbema, vous savez…
Lui, avec force. – Pour cela non… Je l’ai vu le jour de l’ouverture… Je vous affirme que je ne vous y conduirai pas… Ce n’est qu’un parapluie sur un vieux paravent vert… C’est une malice contre Mlle Sarah Bernhardt de dire que c’est son portrait… et vous l’admirez trop et comme femme et comme artiste pour admettre ces méchancetés… Notez cependant que le parapluie et le paravent sont admirablement peints. (Ibid, p. 10)
22Notons le caractère paradoxal des commentaires de Marie de Grandfort, dont la répartition des rôles attribue à l’homme celui de l’amateur, capable de transmettre des opinions et des jugements esthétiques et à la femme, celui de l’inexpérimentée et de la naïve dont les raisonnements sont parfois superficiels. Alors que l’auteure est ici capable de mener un discours esthétique objectif, elle reproduit une tradition évoquée par Laurence Brogniez (Brogniez, 2005, p. 119), celle des critiques développées dès le XVIIIe siècle assignant aux femmes les effets plaisants et aux hommes le sérieux de la réflexion.
23Pratique tout à fait convenable pour des femmes de lettres du XIXe siècle, l’écriture de chroniques mondaines ou de récits sentimentaux est propice à l’exercice ponctuel de la critique d’art. Accédant bien plus facilement à ces rubriques journalistiques qu’à celles des comptes rendus d’exposition qui nécessitent une prise de position plus délicate pour une femme, ces genres littéraires et ces rubriques considérés comme spécifiquement féminins sont alors détournés au profit de l’écriture d’un discours sur l’art contemporain. En restant néanmoins prisonnières, elles se jouent des codes et des convenances associés au concept de féminité.
Conclusion
24Les stratégies mises en œuvre par les femmes de lettres pour accéder à la pratique critique sont ainsi multiples, se manifestant tant dans la construction de réseaux de professionnels que dans l’écriture même des discours esthétiques. S’efforçant à créer pour elles-mêmes des réseaux professionnels et des opportunités, les critiques actives dans la seconde moitié du XIXe siècle ont usé de multiples stratégies pour accéder à l’écriture et à la publication. Sans nier l’intérêt d’une proximité avec un homme influent, il serait réducteur d’occulter les autres canaux qui leur ont permis de s’illustrer dans la pratique de la critique d’art dans l’ensemble de ses pôles de création. Composant avec les risques et les bénéfices de la sororité en fonction des revues dans lesquelles elles publient, certaines salonnières réussissent à mettre en place des stratégies de promotion et d’autopromotion pour soutenir l’ensemble des actrices du monde de l’art. Se faisant parfois une spécificité d’une critique d’art au féminin, elles légitiment tant leur pratique artistique que leur position de salonnière. Le détournement de certains formats littéraires ou rubriques journalistiques considérés comme féminins, offrant aussi la possibilité à certaines femmes de lettres de s’exercer à la pratique critique, nous interroge sur les formats que peut prendre le discours sur l’art et sur la définition même de la critique d’art.