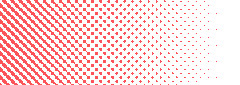« La deffaveur où je vis en mon siecle » : Marie de Gournay inclassable ou déclassée ?
1En 1626, Marie de Gournay s’adresse ainsi à ses lecteurs dans un « advis » liminaire à L’Ombre, premier recueil de ses écrits appelés « meslanges » :
Ny ne doibts pas estre accusée de presomption pour la devise du jeune pin, qui semble d’abbord presager à ces miens ouvrages la faveur de la posterité : car ceste devise sert à declarer que je sens la deffaveur où je vis en mon siecle, & que je proteste une récusation contre luy, qui me rejette par force avec eux autant que je puis vers le siecle futur, plustost qu’elle ne represente aucun espoir que j’aye qu’ils y parviennent (Gournay, 1626).
2Le passage est un ajout au texte de 1608 (Gournay,1608, p. 102‑104), significatif à la fois de la manière dont Gournay ne cesse de travailler la publication de ses écrits sur la longue durée, et dont elle construit par là leur réception changeante, dans des circonstances différentes qui invitent à des opérations de contextualisation fine. L’idée de « deffaveur » postule un isolement de Gournay dans « ce siecle » et a eu une longue postérité : les discours de l’autrice à ce sujet ou ceux de ses détracteurs ont parfois été retranscrits comme des vérités biographiques absolues par une partie de la réception1. Le point d’appui de ce phénomène de « déclassement », ou de cet impossible classement de Gournay dans le xviie siècle, est la question de son anti-purisme2. Alors qu’elle meurt en 1645, après avoir connu le règne d’Henri IV, celui de Louis XIII et la régence de Marie de Médicis qui les sépare, elle a été rangée parmi les auteurs du xvie siècle en raison de ses publications sur la langue et la poésie.
3En revenant sur les discours historiographiques tenus sur Gournay que l’on verra structurés par une « fonction-groupe » (Bridet et Giavarini 2021) et qui ont fortement contribué à marquer le partage entre les deux siècles, puis en revenant au plus près du moment où Gournay publiait ses positions sur la langue et la poésie, en tenant un discours sur sa propre place dans le temps, nous nous proposons de réinterroger sa place supposément hors de son siècle.
1. Les classifications de l’histoire littéraire : Gournay et la langue
4Les écrits de Marie de Gournay font l’objet d’une histoire de réception complexe mais dont il est possible de montrer les mécanismes. En effet, une « fonction-groupe » est à l’œuvre dans la construction de l’histoire littéraire, qui constitue ou reconstitue des couples ou des groupes d’auteurs qu’une même « catégorie » viendrait lier (Bridet et Giavarini 20213). La question linguistique – celle-là même qui a fondé l’éviction originelle de Gournay de l’histoire littéraire du xviie siècle, on va le voir – est le catalyseur de ce regroupement. Cette « fonction-groupe » qui « affirme l’existence de groupes pour raconter la production de la littérature » s’observe de manière assez caractéristique chez Ferdinand Brunot dont le troisième tome de l’Histoire de la langue française des origines à 1900 mentionne Gournay à plusieurs reprises. Dans le deuxième chapitre du premier livre sur « La réforme de la langue (…) » (Brunot, 1909-1911) intitulé « L’opposition à Malherbe », celle-ci est convoquée à la suite de plusieurs détracteurs du poète, simplement nommés, et d’une longue citation de l’Issue aux Censeurs de Jean-Pierre Camus dont Hélène Merlin a montré que celui-ci y prend position contre « les malherbiens » (Merlin, 1994, p. 386). C’est à ce moment-là que Brunot fait intervenir Gournay :
Toutefois, le seul adversaire qui ait discuté en détail les prescriptions et les arrêts de Malherbe, c’est une femme, la « fille d’alliance » de Montaigne, Mlle Le Jars de Gournay. Elle se constitua le défenseur des hommes du xvie siècle, de leur style et de leur langue, contre ceux qui prétendaient les « déterrer du monument » (Brunot, 1909‑1911, p. 11).
5Syntaxiquement mise en relief par la superlative « le seul adversaire qui », Gournay est parallèlement associée à deux figures d’hommes de lettres. Sous la plume de Brunot, elle forme un couple antagoniste avec Malherbe, tandis qu’avec Montaigne c’est celui de « l’alliance » qu’il rappelle et inscrit dans l’histoire tout à la fois. Plus loin dans l’ouvrage, Gournay est encore rapprochée de La Mothe le Vayer, « un auxiliaire […] qui ne craignait point non plus la controverse » (Brunot, 1909‑1911, p. 43). Les prises de position linguistiques de Gournay servent de point focal à ces regroupements. Pour Brunot, elle figure le « défenseur des hommes du xvie siècle, de leur style et de leur langue ».
6L’exemple de Brunot montre bien la façon dont le tout début du xxe siècle se réapproprie la controverse linguistique du premier xviie siècle et en construit le sens. L’historien isole d’ailleurs les « traités » sur la langue parmi les écrits de Gournay4 : ce sont eux seuls qu’il analyse et c’est à partir d’eux seuls qu’il construit toute la réception de l’autrice, celle qui aurait eu lieu au xviie siècle et celle qu’il compose de facto pour les lecteurs du xxe siècle5. Par la suite, ces mêmes écrits continuent d’être qualifiés de « traités » : ils ont d’ailleurs été rassemblés sous ce titre et fonctionnent désormais comme un corpus homogène (Uildriks, 19626).
7L’historiographie des débats sur la langue a cherché à intégrer Gournay à des groupes constitués ou reconstitués, ou à l’opposer à ceux-ci : Malherbe, dans le texte de Brunot, sous-entend le camp malherbien7. Et c’est avant tout à travers cette lecture du xviie siècle par le xixe siècle (Chappey, 2002 ; Viala, 1993) que l’autrice est devenue l’enjeu du partage avec le xvie siècle. Contemporaine de Malherbe, elle a incarné – aux côtés d’autres auteurs – une autre voix linguistique du « Grand Siècle » pour l’historiographie du xixe siècle. Celle-ci s’appuyait sur un travail de réception déjà effectué par les contemporains de Gournay, et en partie configuré par cette dernière. La confrontation des discours historiographiques du xixe siècle et du xviie siècle révèle qu’un même fonctionnement est à l’œuvre dans leur construction.
La Comédie des Académistes (1650)
8Les débats linguistiques et la fondation de l’Académie française ont donné lieu au xviie siècle à des satires dont La Comédie des Académistes de Saint-Évremond est un exemple fameux. Cette pièce, qui a tout d’abord circulé sous le manteau et sous forme manuscrite dans les années 1630 avant d’être modifiée et publiée en trois actes en 16508, fait de Marie de Gournay un personnage du débat mis en scène. L’autrice, assortie avant même son entrée sur scène de la qualification ironique de « sybille Gournai », apparaît à l’acte II ou III selon les versions, et incarne « la tenante de la tradition humaniste et archaïsante » (Viala, 1985, p. 32). La langue de son personnage, au sein des répliques, serait celle qu’avait défendue Gournay et elle s’en trouve à ce titre moquée par Boisrobert, Silhon et Serisay présents dans la scène :
On mesprisait un fourbe au temps que je vous dis,
Un flatteur Boisrobert eust esté gueux jadis,
Et Montaigne et Charron avoient l’ame trop forte,
Pour saisir en renard le recoin d’une porte,
Occuper jour & nuit les plus grands ennemis,
Démentir leur courage & trahir leurs amis. (Saint‑Évremond, 1650, p. 349)
9Cette comédie montre comment les positions de Gournay ont été construites et transmises dès le xviie siècle. Ses écrits sur la langue sont explicitement convoqués à travers une liste de mots que Gournay souhaiterait ardemment conserver : « Ostez moult, ainsi soit, bien que mal à propos, / Mais laissez pour le moins blandice, angoisse & los. (Saint‑Évremond, 1650, p. 35) ». En outre, en la choisissant comme personnage, Saint‑Évremond la fait devenir la cheffe de file d’un groupe qui n’est pas nommé10.
10La réception du satiriste au xviiie siècle montre toute son efficacité rhétorique. L’éditeur de ses œuvres complètes de 1725 identifie Gournay à cette position en faveur des vieux mots :
Mademoiselle de Gournay se disait fille d’alliance de Montagne dont elle a publié en 1635 les Essais corrigés et augmentés. Dans une préface curieuse, qu’elle mit à la tête de cette édition, et dans quelques autres Ouvrages, elle se déclara hautement pour les vieux mots, et les phrases surannées. (Maizeaux, 1725, p. 24).
11Gournay est associée à la figure de Montaigne, non pas seulement en tant que fille d’alliance, mais aussi parce qu’elle a adjoint au texte qu’elle a réédité une préface délivrant ses positions linguistiques. L’éditeur ne cite pas précisément les écrits sur la langue publiés par Gournay, il préfère mettre en lumière un texte d’accompagnement qui là encore associe le nom « Montaigne » au nom « Marie de Gournay » à l’intérieur de la seule question linguistique. Il simplifie par là ce qu’il retient du personnage de Gournay déjà caricaturé dans La Comédie des Académistes.
12La réception de Marie de Gournay s’est ainsi amorcée autour de ce travail de classification qui articule d’une part, une réduction à l’archaïsme fondée sur la querelle de la langue au début du xviie siècle et d’autre part, son association à d’autres auteurs avec lesquels elle forme historiographiquement des « groupes » ou des couples. Le mot « archaïque » est attesté depuis les années 1650 pour décrire un procédé rhétorique d’écriture « consistant à faire usage de mots ou de tournures obsolètes ». Le Trésor de la langue française donne l’exemple d’un emploi du mot par Chapelain en 1659 dans ses Lettres11 : « Il [le jésuite et historien espagnol Jean Mariana (1537‑1624)] a affecté l’archaïsme, mais il l’a fait exprès pour soustenir son stile historique par la gravité ». Le mot a servi à désigner une position passéiste qui ne tenait pas compte des mouvements du temps. La notion a contribué à la simplification du discours de Gournay, un discours tourné tout entier vers le xvie siècle. Mais, pourrait-on se demander, à quelle réalité renvoie ce qui n’avait pas de mot pour la désigner jusqu’alors, puisque Gournay parlait, elle, « d’antiquité » ?
Reclassements au xixe siècle
13C’est en particulier dans la seconde moitié du xixe siècle que Gournay s’est vue reclassée aux côtés d’autres auteurs. Durant cette période de construction et de révision du « Grand Siècle », ses textes linguistiques ont été relus avec une attention toute particulière. Si la filiation avec Montaigne est toujours mise en avant, les historiens du littéraire cherchent à la rapprocher ou à la faire « entrer » explicitement dans des groupes, dans le souci d’écrire une histoire littéraire aux segmentations nettes, identifiables et moins paradoxales.
14À ce titre, Marie de Gournay est évoquée au sein du Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français du xvie siècle de Sainte-Beuve (1843) qui la lie à d’autres auteurs qui pourraient ensemble constituer un camp anti-malherbien revendiqué dans le premier xviie siècle12. Le ton extrêmement polémique de l’autrice est présenté pour la première fois comme une qualité parmi les auteurs qui seraient les derniers disciples de ce que Sainte‑Beuve nomme « l’école de Ronsard » :
En 1623, c’est‑à‑dire cinq années seulement avant la mort de Malherbe, parut sous les auspices de Nicolas Richelet la magnifique édition in-folio de Ronsard. Ce fut comme autour de ce monument sacré que se rallièrent pour une dernière fois les défenseurs du poète ; ils voulaient, ainsi qu’un d’entre eux l’a dit, arracher du tombeau de leur maître cette mauvaise herbe (mala herba) qui étouffait son laurier. Claude Garnier, d’Urfé, Des Yveteaux, Ilardy, Guillaume Colletet, Porchères, La Mothe‑Le‑Vayer, figurent au premier rang parmi ces champions de la vieille cause ; mais aucun d’eux n’apporta dans la querelle autant d’ardeur et moins de ménagement que la fille adoptive de Montaigne, la digne et respectable mademoiselle de Gournay. Cette savante demoiselle rendait à la mémoire de Ronsard le même culte de vénération qu’à celle de son père d’alliance, et elle avait en quelque sorte consacré le reste de sa vie au service et à l’entretien de leurs deux autels (Sainte‑Beuve, 1843, p. 159‑160. Nous soulignons).
15Marie de Gournay serait donc une « prêtresse » du temple montaignien et ronsardien, aux côtés des autres « champions de la vieille cause ». On remarque le champ lexical religieux mais aussi l’étrangeté de ce regroupement : pourquoi mentionner Urfé par exemple qui ne cesse, dès la première réédition de L’Astrée en 1610, de revoir et de moderniser la langue de sa pastorale (Sancier‑Château, 1990 ; Sancier‑Château, 1995 ; Denis, 2007) ? Par ailleurs, Sainte‑Beuve fige plus encore Gournay dans le siècle précédent qu’elle ne paraissait l’être déjà et ce alors même qu’il tente de créer une dynamique de groupe pour le camp anti-malherbien. En soulignant son amour sacré et sa « vénération » de deux figures éminentes du passé, il tourne son activité d’écriture tout entière vers la mémoire de Ronsard.
16S’il travaille d’abord à la reclasser dans un groupe et par un groupe, il la rejette finalement dans ce qui pourrait ressembler sous sa plume à un long xvie siècle expirant sous l’autorité de Malherbe. Il est en cela un héritier de l’Art poétique de Boileau qui, lui-même, hérite de lieux communs constitués au xviie siècle, en partie par Guez de Balzac13. Après l’avoir longuement citée à plusieurs endroits, et notamment avoir mentionné le passage célèbre de sa Deffense de la Poësie et du langage des Poetes – procédant par là-même à un isolement de ce texte hors de tout contexte de publication –, voici ce que conclut Sainte‑Beuve :
Ainsi disait mademoiselle de Gournay ; mais de si éloquentes lamentations furent généralement mal comprises, et ne servirent qu’à lui donner, parmi les lettrés à la mode, la ridicule réputation d’une sibylle octogénaire, gardienne d’un tombeau. Ce fut donc au milieu des rires et des quolibets14 qu’elle chanta l’hymne funéraire de cette école expirante, dont, quatre-vingts années auparavant, Du Bellay avait entonné l’hymne de départ et de conquête, au milieu de tant d’applaudissements et de tant d’espérances (Sainte-Beuve, 1843, p. 164‑165).
17Sainte-Beuve n’est pas le seul historien de la littérature à composer ou à recomposer des groupes littéraires incluant la figure de Gournay. Dans Précieux et précieuses : caractères et mœurs littéraires du xviie siècle, paru en 1895, Charles Livet consacre un chapitre entier à l’autrice après ceux dédiés à Madame de Rambouillet, l’abbé Cotin, Madame Cornuel, l’abbé d’Aubignac et Georges de Scudéry15. Si nous le mentionnons, c’est parce qu’il traite Gournay non plus comme seule disciple de Ronsard ou de Montaigne, mais comme modèle d’un groupe nouveau dont il entend examiner les membres. Son introduction intitulée « De la société précieuse au xviie siècle » s’ouvre ainsi :
Cette période féconde de notre histoire, qui commence avec Richelieu et finit avec Mazarin, n’est pas seulement importante par les résultats politiques obtenus : […] ; il s’y produisit des faits purement civils, indépendants de toute action émanée du pouvoir royal, qui amenèrent à la fois dans les mœurs et même dans la langue des réformes suffisantes pour faire, à elles seules, la gloire du xviie siècle (Livet [1859], 1895, p. 1).
18La « gloire du xviie siècle », ou tout du moins, ce qui constitue pour Livet sa gloire, se forgerait dans les querelles du siècle sur la langue. Il voit en Marie de Gournay, « sous l’autorité de Somaize (dictionnaire des précieuses) et de Jean de Forge », écrit-il (Livet [1859] 1895 : 295), une défenseuse certes polémique – il retrace la réception contrariée de ses textes ainsi que ce qui expliquerait sa « mauvaise » réputation –, mais éclairée de la langue. A posteriori, il souhaite réhabiliter par l’intermédiaire d’un groupe qu’il juge « glorieux » dans le Grand Siècle les positions linguistiques de Gournay. Ce faisant, il déplace l’autrice dans le xviie siècle par sa lecture des précieuses, sans pour autant qu’elle appartienne davantage à son siècle. Il en fait simplement le modèle d’un groupe :
Quelle est, en réalité, la prétention de mademoiselle de Gournay ? Est-ce de revêtir la langue du xviie siècle des habits du xvie ? d’affubler Malherbe de la défroque usée par Ronsard ? Point : tout sa doctrine peut se résumer dans ces deux formules : – faire avancer la langue sans qu’elle doive ou puisse reculer ; – conserver l’usage de la langue entière […].
[…]. Attaquée, mal défendue, sa cause depuis deux siècles pendante devant la postérité : nous l’avons instruite et évoquée. Qu’on la juge (Livet [1859], 1895, p. 294‑295).
19Cette « cause » « instruite et évoquée » au xixe siècle révèle que le reclassement de Marie de de Gournay au sein du xviie siècle a été plusieurs fois travaillé. Mais dans ces deux lectures historiographiques différentes, celle de Sainte‑Beuve et celle de Livet, l’autrice apparaît toujours comme une contemporaine fantôme des débats linguistiques du xviie siècle : capable d’être « entendue » au xixe siècle, mais jamais véritablement dans ce qui constitua pourtant son époque.
20Un auteur contemporain de Gournay avait néanmoins publié sur elle un discours d’une autre teneur. Charles Sorel avait en effet amorcé une défense des positions de Gournay et tenté de donner les raisons qui avaient pu conduire à son éviction de l’histoire littéraire. Il avait cherché à construire cette autre réception que le xixe siècle semble vouloir fonder. Moins de vingt ans après la mort de Gournay, en 1664, Charles Sorel dressait une Bibliothèque française qui, au sein du chapitre « Œuvres meslées », introduisait l’autrice en ces termes :
Qu’on ne se figure point que nous ayons oublié M. de Montagne, dont les écrits ont tant de réputation : nous ne l’avons réservé après les autres qu’afin d’avoir le loisir d’en parler davantage ; il ne sera point mal à propos même de nous entretenir auparavant de sa fille d’alliance, la docte et vertueuse Demoiselle de Gournay, qui nous a laissé un recueil d’ouvrages de sa façon. Dans la première impression il s’appella l’Ombre, et dans la seconde il a porté le nom d’Advis et de Presens de la Damoiselle de Gournay. Il est vrai que beaucoup de gens n’ont pas fait assez d’état de ce livre, faute de l’avoir bien considéré : le chapitre des Diminutifs, et ceux des Observations sur le Langage François et sur la Poésie, ne leur ont point agréé sans doute, à cause qu’ils y ont trouvé des termes qui ne sont plus en usage, et que tout le livre est rempli de métaphores extraordinaires […] (Sorel [1664], 1667, p. 79).
21On peut tout d’abord remarquer ici une inversion chronologique – Gournay est présentée avant Montaigne – qui manipule à plusieurs endroits la façon de présenter non seulement l’autrice, mais aussi et surtout certains de ses écrits : ce sont ceux qui ont servi à la « déclasser » dont Sorel donne précisément les titres. Dans un second temps, il opère une sélection qui pourrait alors, il l’espère, la reclasser si l’on s’intéresse au « sens » et non aux « paroles », c’est‑à‑dire à la langue :
[…] Mais qu’ils prennent garde aux traités de l’Education et de l’Institution des Princes, aux traités de l’Antipathie des Ames basses et des hautes, de la Neantise de la commune Vaillance de ce Temps, et du peu de prix de la qualité de noblesse, et à beaucoup d’autres sujets moraux et politiques, et qu’ils pensent au sens, plutôt qu’aux paroles. Ils connaitraient combien cette illustre fille avait l’esprit ferme et généreux, et comment jugeait sainement les choses (Sorel [1664], 1667, p. 79‑80. Nous soulignons).
22Sorel met en avant les « traités » sur des « sujets moraux et politiques » qu’il juge avoir été masqués par les écrits plus polémiques de Gournay sur la langue. Par ailleurs il renverse les discours moqueurs ordinairement tenus sur le physique et l’âge de l’autrice pour parler de son « esprit ferme et généreux » et donc capable de juger « sainement les choses ». Pour autant, ses « paroles » ont elles aussi un véritable « sens » pour reprendre la distinction qu’il utilise. Plus encore, ses écrits sur la langue et la poésie procèdent d’une véritable stratégie politique bien ancrée dans ce premier xviie siècle tout comme ils sont aussi la trace d’opérations de manipulation du temps par l’autrice elle-même.
2. Reclasser Gournay ? Opérations polémiques de publication entre 1619 et 1626
23Le volume de L’Ombre, paru à la fin de l’année 1626, rassemble les principaux textes de Gournay sur la langue et la poésie qui ont servi à la classer comme une autrice du xvie siècle. Parce qu’un certain nombre d’entre eux avaient déjà été imprimés et parce que cet imposant recueil comprend aussi un grand nombre d’autres écrits portant sur différents sujets, il tend à être principalement appréhendé par la critique comme le premier moment de la constitution des « œuvres » de Gournay par elle-même. Le processus de réunion, de réécriture et de recomposition oriente la saisie de la publication du côté de la production d’un monument tourné vers le futur, dépris de la circonstance qui est une des réalisations du temps présent ou vécu. Un « effet recueil » (Peureux, 2015) contribue ainsi à masquer les opérations polémiques de publication inscrites dans le volume et effectuées par le volume. Sans préjuger d’autres gestes polémiques à l’intérieur de celui-ci16, et en nous penchant sur le travail de reprise et de variation que Gournay effectue sur ces fameux textes consacrés à la langue et à la poésie, nous voudrions regarder différemment la publication de 1626, comme une action dans laquelle Gournay apparaît pleinement « de [s]on siecle ».
24Ce travail est possible parce que la plupart des pièces de 1626 consacrées à la poésie et à la langue reprennent celles d’un ouvrage de 1619, Les Versions de quelques pièces de Virgile, Tacite et Salluste avec l’institution de Monsieur, frere unique du roy, à sa majesté, paru chez l’éditeur Fleury Bourriquant. Or, les deux ouvrages sont couverts par deux privilèges différents, les Versions par un privilège daté du 24 novembre 1618, au nom de la « Damoiselle de Gournay », obtenu pour L’Ombre composée de plusieurs traitez en prose, de quelques versions de Virgile & de Poesie, pour une durée de neuf ans17 ; L’Ombre, par un second privilège, obtenu pour le même titre par « la Damoiselle de Gournay » le 6 septembre 1626, pour six ans et avec mention de cession à l’éditeur Jean Libert18. Il est clair que le premier privilège ne pouvant plus couvrir le livre de 1626 que pendant deux années, il fallait protéger L’Ombre par un nouvel acte administratif. Mais la comparaison des deux privilèges de 1619 et 1626 fait aussi apparaître le contrôle que Gournay entend exercer sur la publication imprimée de ses écrits, et en particulier sur son premier libraire. Le privilège de 1619 précise en effet que « ladite Damoiselle permet à Fleury Bourriquant d’imprimer, vendre et distribuer […] pour cette fois seulement, & sous les conditions accordées entr’eux ; le second Livre de l’Æneide par elle traduict, & l’Institution de Monseigneur frere unique du Roy ; plus un traicté sur la Poësie : le tout faisant partie du Livre sus mentionné »19. Plus classiquement, le privilège de 1626 indique que « ladite Damoiselle a permis au sieur Jean Libert, Marchant Libraire & Imprimeur juré, d’imprimer, vendre & distribuer ledit Livre en vertu dudit privilege lequel elle luy a cedé ». Gournay avait déjà publié chez Fleury Bourriquant, éditeur lyonnais installé à Paris dans la première décennie du siècle et « à l’affut des situations de polémique qui raniment le marché » (Fogel, 2004, p. 169), notamment en matière religieuse. Le privilège de 1619 marque un indéniable geste de retenue (« pour cette fois seulement ») à l’endroit de ce libraire enclin à mettre la sollicitation et la diffusion des imprimés au service de ses intérêts commerciaux, et peut-être de ses idées religieuses. Cette retenue a disparu du privilège de 1626 cédé à Jean Libert, lequel ne risque sans doute pas de détourner l’objet de la publication. L’examen des pièces de L’Ombre consacrées à la langue et à la poésie, presque toutes reprises de l’édition des Versions, fait apparaître la façon dont Gournay entend intervenir de manière ciblée dans l’espace des « lettres nouvelles », et dont, en une opération qui sera reprise par l’histoire littéraire, elle contribue à construire cet espace comme fortement clivé.
Une politique de la langue dans les Versions de 1619
25Le livre des Versions se compose de sept textes. Après une adresse « Au roy » [pièce 1], le Traicté sur la poésie sert « d’avertissement au lecteur » [pièce 2], dans lequel Gournay déclare vouloir imiter Ronsard, Du Bellay, Desportes, mais aussi Bertaut et Du Perron que la « nouvelle poesie », à l’en croire, condamne et qu’ils auraient, eux, tactiquement acceptée. Cette affirmation adressée aux « poetes bastis à l’air recent », ces « nouveaux [poètes] qui prennent un changement d’usage pour une loi »20 (p. 22) s’érige contre une prétention à légiférer depuis la Cour – « trois douzaines d’aigrettes & autant de dames qui vont au Louvre » – à laquelle Gournay oppose l’autorité du « conseil du Roi qui fait la plus solide, prudente, & mieux parlante partie de la mesme Cour » (np) : les lignes qui suivent affirment que ce conseil21 apparaît à Gournay comme le garant de l’unité du « corps de Paris et de la France » en sa langue, quand les courtisans mènent selon elle une stratégie de séparation :
Quand on m’auroit peu persuader que la Cour eust un langage à part, capable de forme visible & de consistance & correspondance à soy-mesme […], il faudroit persuader premierement au Conseil du Roy […] qu’il eust ou parlast une langue distincte du Parlement, & consequemment du corps de Paris et de la France. [np]
26Une vision politique et religieuse sous-tend les positions de Gournay en matière de langue : ce n’est pas le roi qui porte ici l’unité du corps politique, mais une partie de la cour – le « conseil du Roi » – qui est en même temps une partie du « corps de la France », non parce qu’il en serait une partie parmi d’autres, mais au sens où il porte la substance de ce « tout ». Si elle adresse le volume de ces Versions au roi, Gournay n’affirme pas que la langue française est « la langue du roi », mais bien celle d’un « corps » : le Parlement, « et conséquemment » Paris ou la France22. Elle en tient ainsi pour une compréhension « subjective » de l’unité du corps politique, selon laquelle les différents « corps » sont cette unité tout autant qu’ils en font partie. Dans une telle perspective, les pratiques de retranchement, l’affirmation d’un « langage à part » notamment, équivalent à un déchirement de l’unité du corps politique (Merlin‑Kajman, 2001, chap. 3)23.
27L’ensemble du volume des Versions combine stratégie de modestie – Gournay fait lire sa traduction du second livre de l’Énéide en vis‑à‑vis de celle de Bertaut – et recherche d’une position de lettrée auprès du roi auquel le volume est dédié, en se situant dans la filiation explicite du cardinal du Perron, mort l’année précédente, en 1618. L’épître à Louis XIII [pièce 1] s’ouvre ainsi sur l’affirmation que « Feu M. le Cardinal du Perron disoit souvent que nos Roys devoient proposer prix à diverses personnes de capacité choisie, pour traduire à l’envy les plus dignes Orateurs & Poetes Latins, surtout Virgile ». La filiation établie avec celui qui a prononcé l’oraison funèbre de Ronsard en 1585, au collège de Boncour, fonde l’autorité de la position qu’en ce moment 1619, Gournay tente de définir pour elle-même dans la politique des lettres de son temps. Cette position se renforce par la publication, en toute fin de volume [pièce 7], d’une « institution du prince », adressée à Gaston d’Orléans dont Gournay avait déjà célébré la Bienvenue en 1608, mais sans l’accompagner alors d’un discours sur la poésie héroïque et la langue (Gournay, 1608)24. Or, c’est bien ce discours qui relie les différentes pièces du recueil de 1619 les unes aux autres et définit, dans le temps de la prise du pouvoir du fils d’Henri IV, le sens d’une politique à l’égard des lettrés. Situé à une place stratégique dans le recueil, entre l’adresse au roi et la première pièce de traduction [pièce 3], le Traité de la poésie motive la proposition de Gournay de suivre le modèle de ces prélats poètes (Bertaut) et orateurs (du Perron) qui avaient été les grands commis du gouvernement d’Henri IV et que l’explosion des recueils collectifs des années 1600 avaient consacrés (Fragonard, 2010, p. 49‑71, et 59‑60 en particulier25). L’opération de 1619 vaut invitation pour le roi à poursuivre la politique de l’éloquence et de la parole publique engagée par son père. De tels appels à une continuité politique figurent d’ailleurs dans de nombreux textes des années 1617‑1619 adressés au jeune Louis XIII, et qui n’étaient pas nécessairement du même bord. Mais la manière dont Gournay définit le sens politique et religieux de la continuité, l’action par laquelle elle tente par là de trouver une place de lettrée auprès du roi, rendent perceptible la tension qui traverse son analyse du changement historique et la manière complexe dont elle entend par là se montrer « de son temps ».
Une action polémique dans l’espace des « lettres nouvelles » : L’Ombre de 1626
28Toutes les pièces de l’ouvrage de 1619 sont reprises et réorganisées dans les deux livres qui composent L’Ombre de 1626. Le contexte désigné par « l’œuvre de meslanges » est cependant tout différent, une nouvelle adresse au lecteur l’interpelant pour lui présenter l’ouvrage comme « un querelleux, un rabajoye, perpetuel raffineur de mœurs & de jugement : qui t’espie de coin en coin pour te mettre en doubte, tantost de ta prud’hommie, tantost de ta suffisance » (np). L’épître au roi de 1619 est rejetée au milieu du livre II, juste avant la double traduction de l’Enéide [pièce 3 de 1619], et n’apparaît pas dans la table des matières. Surtout, presque au terme de la série de trente pièces qui constituent le livre I de L’Ombre, la Deffense de la poésie [l. I pièce 28] reprend et développe le Traité de la poésie de 1619, mais s’adresse maintenant à Mme des Loges, intermédiaire importante entre les lettrés et la cour, fréquentée par Malherbe, et qui venait de condamner l’immoralité de Théophile de Viau (Timmermans, 1993 et Fogel, 2004, p. 238 et 269). Plus nettement que les Versions, l’ouvrage de 1626 s’affirme comme un geste d’intervention dans ce que l’on appelle alors les « lettres nouvelles », reconfigurées par le scandale des Lettres de Guez de Balzac (1624‑1625) tout autant que par le procès de Théophile de Viau (1623‑1625). Il accentue l’attaque contre « les poètes nouveaux », déjà moqués dans le Traicté de 1619, et mobilise pour cela de nouveaux écrits : le traité des Métaphores, celui Des rimes [livre I, pièces 18 et 22] ainsi que l’essai sur la manière d’escrire de Bertaut et Du Perron [l. II pièce 6], placé entre de nouvelles traductions et celles de 1619 dans le second livre consacré aux orateurs et à « l’oraison ». Dans tous ces textes se lit une nette volonté de polémiciser le discours sur la langue et la poésie qui, bien plus que des « traités philologiques »26, nous apparaissent comme des libelles adressés à un « camp » que Gournay constitue en partie27 : si Michèle Fogel a contextualisé le volume dans l’affaire Théophile de Viau (Fogel, 2004, chap. xi), la teneur des textes sur la poésie et la langue invite aussi à regarder du côté des effets de groupe causés, cette même année 1626, par la parution du Recueil des plus beaux vers de Messieurs de Malherbe, Racan, Monfuron, Maynard, Bois-Robert, chez l’imprimeur en vue, spécialisé dans les « lettres nouvelles » qu’est Toussaint du Bray, avec un privilège daté du 2 juin 1626. Action du libraire ou du publicateur du recueil, le volume produisait en effet du groupe en postulant une « esthétique », pourtant difficile à dégager des « fameux Esprits de la Cour » mis en évidence par le titre de l’ouvrage (Bombart, Cartron, Rosellini, 2021, introduction).
29Avec les libelles que publie L’Ombre, Gournay travaille cet effet de groupe qu’elle n’est certes pas seule à mobiliser mais que l’identification d’une supposée esthétique de la poésie à la cour contribue à localiser. Le « groupe » (ou la fonction‑groupe de son discours) sert ici une attaque contre le déplacement du centre de la vie lettrée et de l’autorité poétique du côté de la cour, déplacement qui est par ailleurs l’objet de multiples interventions de la part des littérateurs et auteurs, depuis le père Garasse dont on se souvient qu’en 1623, il attaquait précisément en Théophile de Viau un poète bien en cour (Godard de Donville, 1990) jusqu’à Charles Sorel moquant la servilité des poètes courtisans dans les ajouts importants du livre V du Francion, en 1626.
30Pour sa part, Gournay rappelle ceux qui font pour elle autorité : De la manière d’escrire de Bertaut et Du Perron reprend des passages du matriciel Traicté de la poesie pour faire des deux prélats les continuateurs de Ronsard, Du Bellay et Desportes, et les seuls « réformateurs » qu’elle accepte. Tout au long du texte, la « nouveauté » de ce qui est présenté comme un parti est pointée avec virulence, produisant activement un effet de groupe (« nouvelle Poésie » p. 943, « nouvelle Bande » p. 942, « nouveaux Poetes » p. 941 et p. 946, « nouveaux artistes », « Poètes de nouvel art », p. 948) dont elle récuse l’unité supposée :
ceux de ceste compagnie sont tres divers entr’eux, & de plus, divers à eux-mesmes par diverses heures, en la pluspart de leurs paroles et jugemens, aux choses propres de leur cabales (p. 943).
31Le procédé de l’accusation n’est pas sans évoquer le discours anti-libertin de ces mêmes années : les poètes de cette « compagnie » sont divers entre eux, livrés à la diversité de leur « caprice » ; ils forment une « compagnie », non un corps. Le texte de Gournay expose moins des positions antagonistes en matière de poétique qu’il n’emprunte à la satire et au je impliqué du satirique la tonalité acerbe d’un discours sur l’époque et de l’espace des lettres du « temps » :
nous sommes en un temps où le fard est pris pour grace & la bouffissure pour embonpoinct ; et que bouffisseure & fard, choses que je n’ayme pas beaucoup, ne se peuvent trouver avec ces restrictions & subjections que j’observe. (p. 940)
32On ne trouvera donc dans ces lignes aucune analyse « poétique » de Bertaut et Du Perron, ceux-ci étant principalement utilisés pour les exemples de mots et de rimes qu’ils auraient autorisés.
33Dans la Version des poetes antiques ou des metaphores [l. I, pièce 18], Gournay reprend l’adjectif qui qualifiait le lecteur de 1608 (« Au lecteur français »), mais qui a disparu de l’avis de 1626 : « Quelle conception non simple mais lasche et avachie & fade, dirons-nous avoir l’Escrivain François, qui parlera simplement, veu qu’il use d’un langage tant inferieur à celuy de Gallus ? » (p. 432). Et à propos de la diversité dialectale qui motive les rimes pour l’œil, un passage Des Rymes affirme encore que « nous autres purs François devons detordre & redresser, non pas suivre les barragouins » (p. 489) ; un autre oppose une manière proprement française d’être dans la langue au choix d’une éloquence déliée de toute appartenance, et qui ne vaudrait que pour celui qui parle : « Le langage simple nous fait voir que c’est un François qui parle : la figure & la metaphore nous montrent que c’est un homme qui raisonne & discourt » (p. 433). Enfin, dans Du langage françois qui figure dans ce même livre I, c’est l’équivalence entre « parler parfaitement » et « parler François pur et trivial » (p. 185) que souligne Gournay, en affirmant que ceux qui prennent alors position pour la « simplicité » renoncent à une universalité française de la poésie et à une exigence à laquelle ils ne peuvent de fait se hisser.
34Or mobiliser ainsi le terme français en 1626, c’est reprendre, c’est réactiver un mot (« bons français », « vrais français ») qui a été objet d’appropriations concurrentes entre dévots et « politiques » dans les libelles des guerres de religion, puis au moment des États généraux de 1614‑1615. Tous les partis tentaient alors de se situer, depuis leurs positions antagonistes, dans la transformation théologico-politique du royaume. Gournay utilise l’adjectif à la fois pour accentuer la teneur polémique de ses positions en matière linguistique, et pour en travailler la valeur.
35Des Rymes montre par ailleurs que la défense de la varietas, le refus du « rebut » des vieux mots ne se confond pas chez elle avec une pensée de la division politique, ou de la fragmentation du royaume28, mais que sa défense de la liberté d’une poésie héroïque émancipée se donne bien comme un projet politique, au même titre que l’est le « purisme » : le refus des rimes « pour l’œil » est un refus de la division qui ordonne les langues, un refus de la variété dialectale dans la poésie29. Mais dans le même temps, Gournay récuse la simplification postulée par la « nouvelle poesie », en identifiant le royaume qui serait soumis à une telle rigueur à une « tyrannie », à un espace des lettres bien trop élargi :
Lairrons-nous d’aller à deux bonnes jambes, pource qu’un boitteux ne nous peut suivre avec la sienne eclopée ? & le Soleil lairra il de luire à cause que la splendeur de ses rayons esblouït de foibles yeux ? Certainement, si nous proportionnons un Escrit ou un Poëme pour bien achevé qu’il soit, à toutes sortes d’esprits, la plus grande part sont si bas, qu’il faudra que la compagnie nous remercie, de luy avoir servy un beau bouillon d’eau pure & claire. (p. 191‑192)
36L’éclairage donné sur les lettres par cette perspective qui assume ce que nous serions tentés d’appeler un « élitisme » – et qui va avec l’affirmation de l’unité linguistique et politique de la France – fait apercevoir la volonté qu’a Marie de Gournay de maintenir dans des limites étroites l’espace des productions lettrées dans le moment précis où les « bonnes lettres » deviennent « belles lettres », le moment où s’ouvre un champ littéraire en quelque sorte.
37« On n’escrit plus ainsi » (p. 441, p. 442) : cette formule prêtée à un parti adverse souligne la différence entre le passé réduit à « la vieille mode » et la pensée du temps qui se lit dans le rapport à des modèles ou à ce qui est donné par Gournay comme une origine. Le refus de l’imitation « du faible dialecte de quelques courtisans » (p. 425) consonne certes avec le refus d’imiter Malherbe chez un Théophile de Viau. Mais Viau entendait « écrire à la moderne », il revendiquait une liberté d’écriture et d’action qui, tout en reprenant la tradition satirique, travaillait et manipulait la question de la dépendance sociale (Parmentier, 2008). Pour sa part, Gournay ne cesse de poser l’antériorité de Ronsard dans la poésie, réactivée par l’imitation et par l’éloge de Bertaut et de Du Perron. Tel que configuré par son idée d’une « antique poesie, speculative, haute, imperieuse » (p. 438), le temps se construit et se vit à partir d’une origine qui peut revenir dans le présent, une origine dont la reconnaissance et la préservation est la condition d’un retour et d’une amplification : origine de l’autorité de Gournay dans la filiation de Montaigne, de Du Perron, de Bertaut ; origine des « premiers poètes » que ceux qui les contestent ne peuvent égaler (Des métaphores, p. 442 sq.) ; origine d’une « culture » pour reprendre le terme utilisé à propose de l’accroissement de la langue dans le temps (Du langage françois, p. 188). À l’époque de Gournay, le discours des origines est en particulier porté par des textes zélés, par ceux qui vivent le schisme religieux et la construction absolutiste comme une perte de l’unité (et de la pureté) du catholicisme, une perte des origines justement. Ces origines, les lettres nouvelles, bientôt les belles-lettres peuvent fantasmatiquement en produire le retour dans des fictions – pensons à L’Astrée d’Urfé, qui travaille avec la littérature une fiction des origines et le sens d’une recomposition politique et sociale autour du roi (Giavarini, 2020). Mais pour Gournay, dévote en poésie, la langue peut aussi activer un tel retour, s’il est vrai du moins que, hors de la mode, c’est autre chose qui se joue dans la préservation « des vieux mots ».
38Le livre de 1626 marque néanmoins des hésitations tactiques et des manipulations ponctuelles au jugé quant à la posture qu’elle adopte dans l’espace de lettres nouvelles. Par exemple, elle enlève de l’avis au lecteur de 1608 un passage qui soulignait ses « sentiments moulez à l’air d’un autre Siecle », expression qui s’insérait entre sa « franche simplicité », « ses desseins ourdis à sa mode » et « son peu de méthode & de doctrine ». Sans doute ne convient-il plus de présenter ces « sentiments » comme appartenant au passé – alors même que ce passé s’est encore éloigné –, et de prêter le flanc à l’ironie ou à la dévaluation balzacienne, étalée dans la lettre de 1624. Mais il lui est en même temps possible de jouer volontairement les vieilles dames : elle garde ainsi, à la fin de la Deffense de la poesie, une phrase du Traité de la poésie qui construisait l’homologie entre sa défense des anciens et sa propre position dans le temps, se disant heureuse de faire aimer « l’antiquité » à ses lecteurs : « puisqu’estant moy mesme de cette datte, j’espereray de grapiller parmy le marché quelque parcelle en ta bonne grace » (p. 643). En 1619, Gournay avait 54 ans. Elle en a 61 en 1626 au moment de la publication de ce volume qu’elle clôt par une « imprecation [contre] cet impertinent siecle », interdisant à quiconque si son Livre lui « survit » « d’y adjouster, diminuer, ny changer jamais aucune chose, soit aux mots soit en la substance ».
39Ferdinand Brunot soulignait dans l’Histoire de la langue française le caractère collectif du choix de la « doctrine » et du refus de l’archaïsme. « Tout le monde habite la grammaire » (Brunot [1899], 1909‑1911, « De l’Archaïsme », p. 249‑81), affirmait-il en citant significativement un vainqueur des années 1620, Guez de Balzac : défendant les vieux mots, Gournay aurait donc choisi la maison ancienne et délabrée d’un vieux langage ; elle se serait elle-même classée et isolée dans le passé. Dans un registre différent de Brunot, mais en lien avec son propos, Jean Delabroy a insisté lui aussi sur le caractère collectif de l’évolution poétique au tournant du xvie siècle, soulignant la façon dont les cercles de Caen et de Rouen, laboratoires de poésie, avaient alors produit une émulation réciproque entre poètes (Delabroy, 1975).
40Une telle affirmation de l’élan national vers « la réforme de Malherbe » évacue la complexité des positionnements qui se lisent dans les publications du temps, et l’espace des actions, restreint sans doute mais qui a néanmoins existé, dans lequel certains auteurs ont tenté de configurer l’articulation des lettres et de la politique pendant les années 1620. Impliqué dans ces actions de promotion des lettres et des lettrés, le débat sur la langue et la poésie offrait une perspective sur l’unité (ou la division) du corps politique (du royaume) différente de la définition de l’unité du corps politique selon les dévots. La virulence des positions de Gournay qui publie L’Ombre dans un temps où les positions zélées à l’égard des littérateurs ont pu sembler l’avoir emporté fait donc surgir le problème de l’héritage dans un temps de changement. Mais elle fait aussi apercevoir la place que jouèrent les « lettres nouvelles » dans les recompositions sociales et politiques auxquelles furent alors conduits les contemporains, et les chemins divers qu’empruntèrent ces repositionnements. Cette diversité explique en partie les contradictions apparentes qui émaillent les récits de l’histoire littéraire, comme celle qui décrit un Malherbe introduit à la cour par le cardinal Du Perron, lequel est pourtant un ardent défenseur de Ronsard. On ne peut comprendre la complexité des positions des acteurs du passé si l’on reproduit les stratégies groupales qu’ils mobilisèrent dans leurs actions propres, qu’ils aient été libraires, auteurs ou publicateurs.
41Les actions d’écriture de Gournay montrent qu’elle a tenté de jouer sa carte dans ce moment qui est au cœur des déchirements des années 1620, qu’elle a bien été ainsi « de son siecle »30. Elle l’a fait non pas seulement de manière défensive comme on le lit souvent, mais en adoptant une tactique conflictuelle consistant à très fortement cliver le discours sur la langue et la poésie de son temps, en jouant pour cela de l’autorité de son âge et en proposant avec vigueur, âpreté même, un modèle du rapport au passé qu’elle maintint par la suite31, mais qui dans un temps d’accélération des ruptures a contribué à la ranger du côté des vaincus de l’ordre socio-politique nouveau.